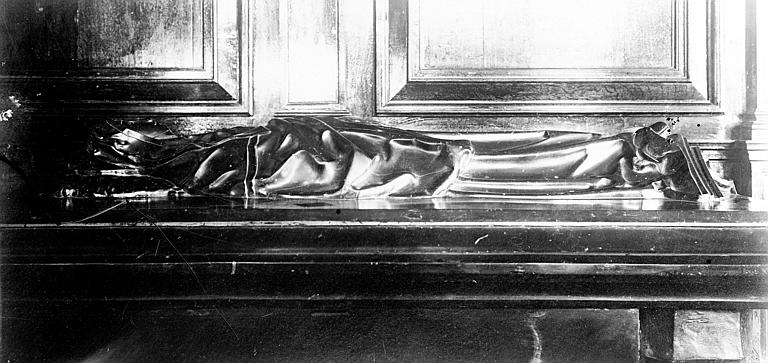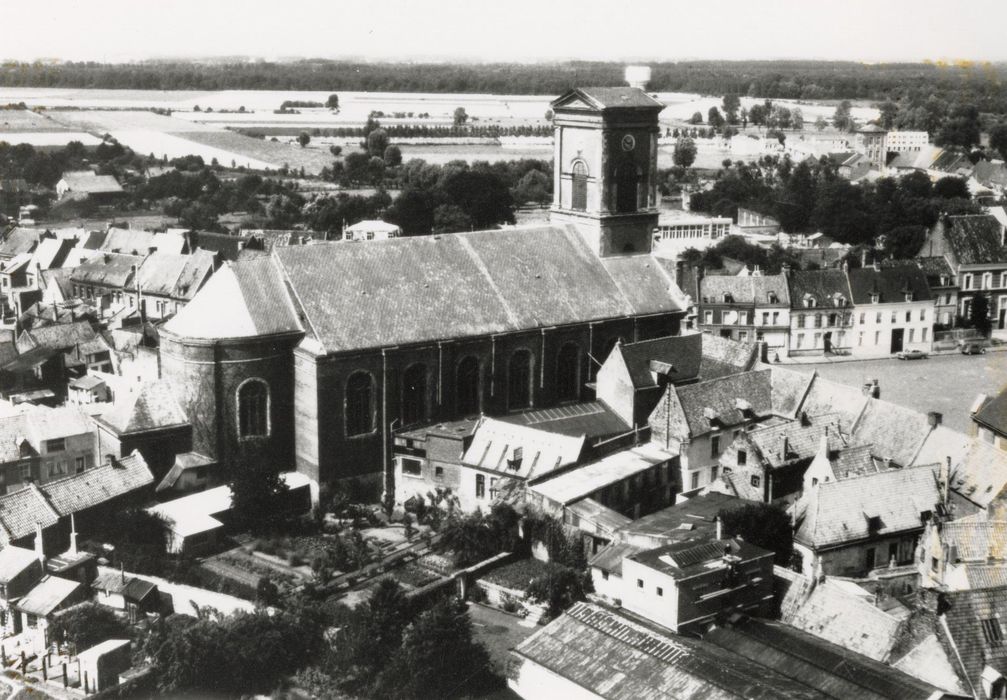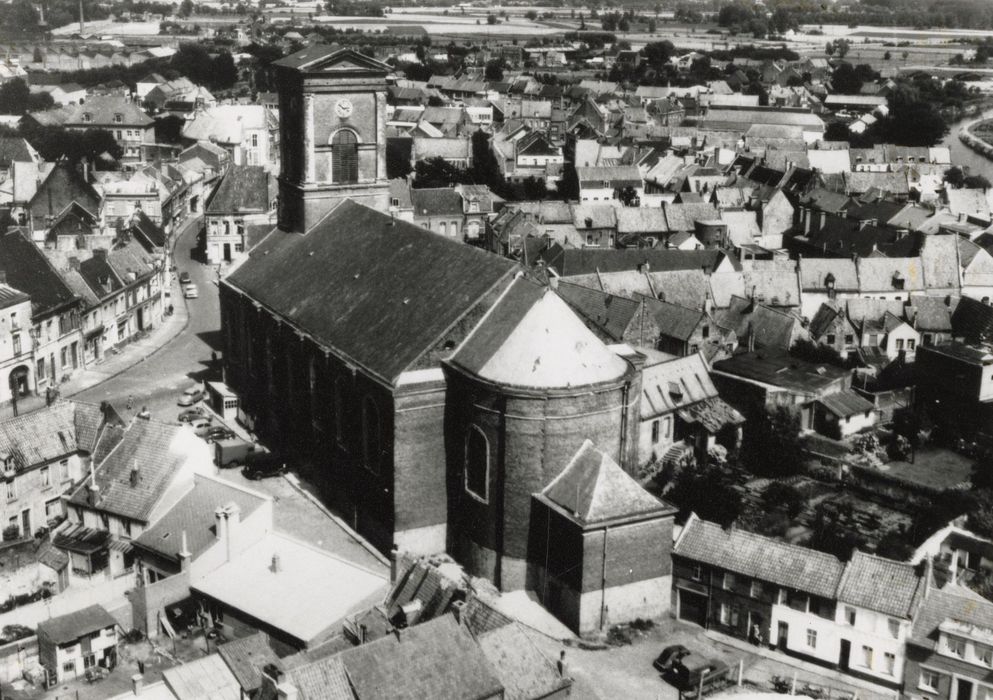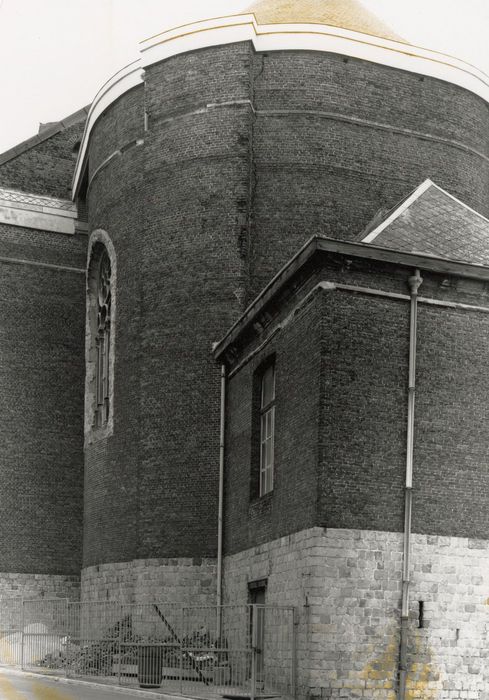Eglise Sainte-Rictrude
Désignation
Dénomination de l'édifice
Église
Titre courant
Eglise Sainte-Rictrude
Localisation
Localisation
Hauts-de-France ; Nord (59) ; Marchiennes ; place du Général-de-Gaulle
Précision sur la localisation
Anciennement région de : Nord-Pas-de-Calais
Adresse de l'édifice
Général-de-Gaulle (place du)
Références cadastrales
C 1422
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
3ème quart 18e siècle ; 1er quart 19e siècle
Année(s) de(s) campagne(s) de construction
1786 ; 1811
Commentaires concernant la datation
Daté par source
Auteur de l'édifice
Commentaires concernant l'attribution de l'édifice
Attribution par source
Description historique
Depuis le moyen-âge, une église paroissiale entourée d’un cimetière se trouvait à proximité de la place, à l’écart de l’abbaye bénédictine. Sa reconstruction fut décidée en 1779 et confiée à l’architecte lillois J.F.J. Lesaffre (1731-1803). Après le transfert du cimetière à l’extérieur de la ville, les travaux commencèrent à la fin de 1786 ; le gros-oeuvre était achevé, quand, le 18 décembre 1790, la tour de l’église s’effondra sur la nef. Après la Révolution, c’est un autre architecte lillois, B.A. Dewarlez-Lepers (1768-1819), qui fut chargé de remonter les voûtes et la tour. Les travaux furent adjugés en 1811 et achevés en 1815. Dewarlez dessina aussi le mobilier, dont seules subsistent les stalles et la clôture qui les surmonte. L’aménagement intérieur et l’ameublement ont été complétés ou renouvelés tout au long du 19e siècle. En 1864, l’architecte tourquennois Charles Maillard (1821-1875) conçut « la décoration architecturale de l’intérieur de l’église », jugée trop dépouillée : les voûtes, les arcs, les baies… ont été ornés d’un riche décor de plâtre. En 1903, dans un contexte de tensions entre l’Eglise et l’Etat, la commune fit graver la devise républicaine sur le fronton de la façade. Courant néoclassique.
Description
Matériaux du gros-œuvre
Brique, calcaire, grès
Matériaux de la couverture
Ardoise
Typologie de plan
Plan allongé
Typologie du couvrement
Voûte en berceau, voûte en coupole
Typologie de couverture
Toit à longs pans
Commentaire descriptif de l'édifice
Les matériaux proviennent de la région : pour le soubassement, le grès ; en matériau principal, la brique, dont la couleur est relevée par le calcaire blanc utilisé pour le décor architectural. Le traitement de la façade, sommée d’une tour, a été privilégié ; austère, elle peut être lue comme une combinaison de formes géométriques. On peut y lire l’influence de l’architecture italienne palladienne du 16e siècle. L’église ne comprend pas de transept. Fidèle à une tradition régionale, la haute colonnade sommée d’arcs en plein cintre conduit le regard vers l’abside. Cette abside est de plan circulaire, forme peu fréquente utilisée cependant au 18e siècle pour la chapelle axiale de grands édifices (Saint-Roch à Paris en 1705, plus localement la collégiale Saint-Pierre à Douai vers 1745). L’éclairage est fourni par les baies latérales, qui, à l’origine, ne comportaient ni décor ni vitraux. L’impression dominante est celle de l’ampleur des volumes et de la luminosité ; il faut s’imaginer l’église en 1815, à l’issue de sa reconstruction partielle, blanchie à la chaux, peu meublée, sans le décor de moulures ajouté en 1864 : une architecture sobre, conforme au goût néoclassique de la fin du 18e siècle.
Technique du décor des immeubles par nature
Sculpture
Protection et label
Nature de la protection de l'édifice
Inscrit MH
Date et niveau de protection de l'édifice
1992/05/06 : inscrit MH
Précision sur la protection de l'édifice
Eglise Sainte-Rictrude (cad. C 1422) : inscription par arrêté du 6 mai 1992
Nature de l'acte de protection
Arrêté
Référence aux objets conservés
PM59001022 ; PM59001921 ; PM59008120 ; PM59008121 ; PM59008122 ; PM59008123 ; PM59008124 ; PM59008125 ; PM59008126 ; PM59008127 ; PM59008128 ; PM59008129 ; PM59008130 ; PM59008131 ; PM59008132 ; PM59008133 ; PM59008134 ; PM59008135 ; PM59008136 ; PM59008137 ; PM59001021
Intérêt de l'édifice
À signaler
Observations concernant la protection de l'édifice
Objets mobiliers classés et inscrits.
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
Propriété de la commune
Références documentaires
Copyright de la notice
© Monuments historiques, 1992. Cette notice reprend intégralement les termes de l’arrêté de protection au titre des Monuments historiques. Elle répond à l’obligation réglementaire du ministère de la Culture d’établir la liste générale des édifices protégés (art. R. 621-80 du Code du patrimoine). Elle est donc opposable et fait foi juridiquement. Aucune copie numérique ou papier ne sera fournie par courrier ni courriel. Le dossier de protection complet et l’arrêté sont consultables uniquement sur place, dans la salle de lecture de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP), à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).
Date de rédaction de la notice
1992
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
Dossier de protection