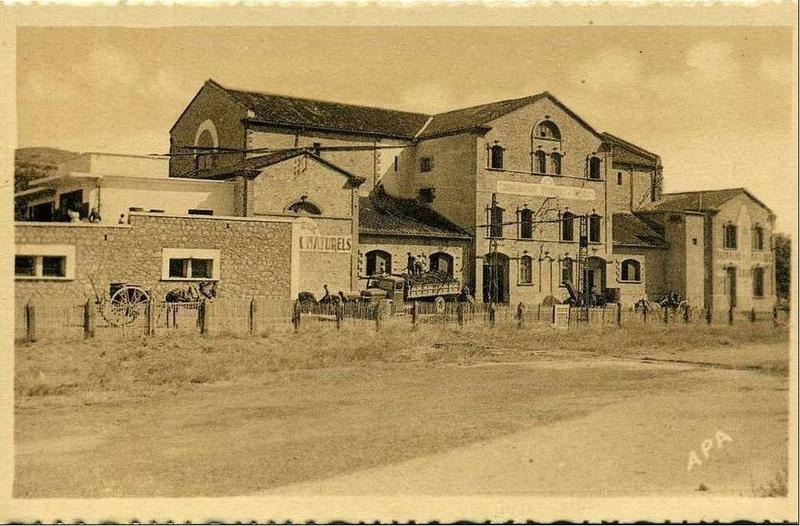Cave coopérative les Vignerons de Maury
Désignation
Dénomination de l'édifice
Établissement vinicole
Précision sur la dénomination de l'édifice - hors lexique
Coopérative vinicole
Titre courant
Cave coopérative les Vignerons de Maury
Localisation
Localisation
Occitanie ; Pyrénées-Orientales (66) ; Maury ; 128 avenue Jean Jaurès
Précision sur la localisation
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon
Adresse de l'édifice
Jean Jaurès (avenue) 128
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
1er quart 20e siècle
Année(s) de(s) campagne(s) de construction
1911
Auteur de l'édifice
Description historique
L' origine de la cave coopérative de Maury remonte au mois d' août 1907 pendant lequel est fondé un syndicat professionnel agricole et viticole qui prévoit la création d' une cave de vinification en commun. Si dès décembre 1907 un projet de cave coopérative et de subventions est lancé, celle-ci ne sera construite qu' entre mars et août 1911. L' ingénieur et architecte Pierre Paul, auteur notamment de la cave de Maraussan dans l' Hérault, est chargé des plans. Rapidement, en mai 1913, un premier projet d' agrandissement voit le jour, suivit d' un deuxième réalisé en 1920-1921 puis d' un troisième projet en mars 1939. Le développement de la cave est rendu possible par l' agrandissement des chais existants, par l' ajout de chais derrière et sur les côtés de la cave primitive ou encore par l' installation de cuves en inox. La cave est toujours en activité en 2013.
Description
Commentaire descriptif de l'édifice
La cave primitive est composée d' un bâtiment central à deux étages carrés, dont la façade ouvre sur le mur pignon cantonné de deux pilastres en briques, et de chais latéraux. La façade du corps central est divisée en trois niveaux par des bandeaux courants qui soulignent les appuis de fenêtres. Au deuxième étage, on compte quatre fenêtres parmi lesquelles deux sont disposées en baie géminée et surmontées d' un tympan aveugle. Le premier étage est percé par quatre fenêtres couvertes d' arcs segmentaires en brique. Au rez-de-chaussée, et au centre du mur pignon de la façade est conservée une grande baie étroite, aujourd' hui murée, qui abritait la chaîne à godet brevetée par Pierre Paul. Elle servait à monter la vendange à l' étage. Les raisins étaient amenés par des wagons Décauville dont la voie courait devant la cave. Les grappes étaient versées dans un conquet et pesées avant d' être montées par la chaîne. Un chai transversal, agrandi par la suite, coupe perpendiculairement le corps central. Enfin, les deux autres chais latéraux qui étaient à l' origine en moellons irréguliers de pierre calcaire apparente ont été par la suite surélevés d' un étage et leur façade enduite.
Protection et label
Observations concernant la protection de l'édifice
Labellisé par la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites du 14 février 2013
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
Propriété privée
Références documentaires
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2013
Copyright de la notice
© Monuments historiques
Date de rédaction de la notice
2013
Noms des rédacteurs de la notice et du dossier
Wienin Michel ; Sauget Jean-Michel ; François Michèle
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
Dossier individuel
Accès Mémoire
LABELXX-LR