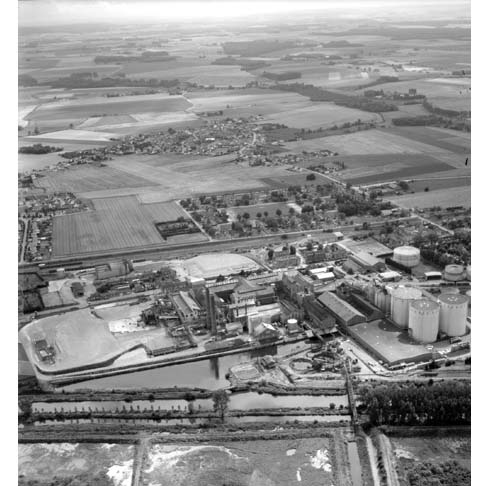Ensemble industriel de la sucrerie d'Eppeville
Désignation
Dénomination de l'édifice
Ensemble industriel
Titre courant
Ensemble industriel de la sucrerie d'Eppeville
Localisation
Localisation
Hauts-de-France ; Somme (80) ; Eppeville ; rue du Maréchal-Leclerc ; rue de Nesle
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Haute-Somme
Canton
Ham
Adresse de l'édifice
Maréchal-Leclerc (rue du) ; Nesle (rue de)
Références cadastrales
1985 A 164, 165, 168 A 175, 177, 178, 180 A 184, 186 A 188, 317, 370 A 372, 398, 447, B 390 A 402, 404 A 422, 430 A 546, 560 A 564, 630
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
En village
Nom du cours d'eau traversant ou bordant l'édifice
Canal de la Somme
Partie constituante non étudiée
Cantine ; logement d'ouvriers ; logement de contremaître ; logement patronal
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
1er quart 20e siècle ; 2e quart 20e siècle ; 2e moitié 20e siècle
Année(s) de(s) campagne(s) de construction
1901 ; 1941 ; 1945
Commentaires concernant la datation
Daté par source
Auteur de l'édifice
Commentaires concernant l'attribution de l'édifice
Attribution par source
Personnalités liées à l'histoire de l'édifice
Sommier Edme (promoteur) Tabary Emile (promoteur)
Description historique
Sucrerie créée en 1857 par Bostenn et Cie, connue en 1894 sous l'appellation Bocquet et Cie et transformée la même année en S.A. Sucrerie d'Eppeville. Cette sucrerie est dynamitée par l'armée allemande comme la plupart des sucreries du Santerre pendant la Première Guerre mondiale. Création de la Compagnie Nouvelle des Sucreries Réunies, concentration capitaliste de 14 sucreries d'avant guerre grâce à l'initiative de 2 personnalités, le raffineur parisien Edme Sommier et l'ingénieur Tabary Emile, directeur d'une grosse sucrerie de l'Aisne. Le site est encadré par le canal, la voie ferrée Amiens-Tergnier. Il est traversé par la route nationale 30. Edme Sommier choisit l'architecte Georges Lisch qu'il employait alors aux travaux de son château de Vaux-le-Vicomte. Les acquisitions foncières sont entreprises dès 1919 et sur diverses terres et fermes, notamment en bordure du canal, constituant un ensemble de 190 000 m². Les études menées par Emile Tabary et par Georges Lisch permettent la reconstruction entre 1919 et 1922 par la C.N.S.R. : grand atelier principal à fronton circulaire construit par l'entreprise Hersent ; subsiste un logement d'ouvrières date 1901 ; à nouveau reconstruite en 1941, date portée sur cheminée, et en 1945. A fusionné avec les raffineries Saint-Louis de Marseille sous le nom sucreries raffineries Sol Bouchon Saint-Louis S.A., devenue en 1968 la générale sucrière ; nombreuses extensions 2e moitié 20e siècle. Installation en 1919 du matériel Skoda, 600 ouvriers tchèques, 75 Km de canalisations, 4 râperies ; 1922 : distillerie de mélasse, puis en 1931 de jus. 1857 : mention de travail nocturne d'enfants ; 1939 : 1200 ouvriers en fabrication, 500 en inter campagne ; 1962 : plus de 500 salariés ; 1983 : 700 ouvriers ; 1986 : 591 salariés.
Description
Commentaire descriptif de l'édifice
Site industriel desservi par voie navigable, embranchement ferroviaire ; atelier principal en brique et pan de fer à élévation ordonnancée avec fronton orné, toit à longs pans brisés et comble à surcroît avec ciment en couverture ; chaufferie, salle des machines, four à chaux et magasins industriels en brique et pan de fer, toit à longs pans et comble à surcroît ; bureau en brique à un étage carré et étage de comble, toit à longs pans ; logements d'ouvriers en brique à élévation ordonnancée sans travées ; deux cheminées d'usine à base tronconique h environ 30 mètres ; surface du site en m2 : 190000. L'ensemble se compose des édifices suivants : l'unité de production de la sucrerie, un immeuble de bureaux, un immeuble de direction avec bureaux et habitation de l'administrateur et son parc, 2 maisons d'ingénieur (+ 2 maisons d'ingénieur jamais réalisées) , 4 maisons de contremaîtres, des maisons de contremaîtres jumelées, des logements ouvriers mitoyens, une cité ouvrière de 26 logements dite Cité Germaine, des dortoirs (3 immeubles de logements ouvriers collectifs) , une cantine et cuisine, un dispensaire.
Commentaires d'usage régional
Charpente métallique apparente
État de conservation (normalisé)
Restauré
Protection et label
Intérêt de l'édifice
À signaler
Eléments remarquables dans l'édifice
Atelier de fabrication
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
Propriété privée
Références documentaires
Date de l'enquête ou du dernier récolement
1983 ; 2003
Copyright de la notice
© Inventaire général ; © Inventaire général
Date de rédaction de la notice
1988 ; 2003
Noms des rédacteurs de la notice et du dossier
Dufournier Benoît ; Bailly Gilles Henri ; Caulliez Stéphanie ; Laurent Philippe
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
Dossier avec sous-dossier
Accès Mémoire
Patrimoine industriel
Adresse du dossier Inventaire
Conseil régional Hauts-de-France - Service de l'Inventaire du patrimoine culturel 21 mail Albert-Ier 80000 Amiens