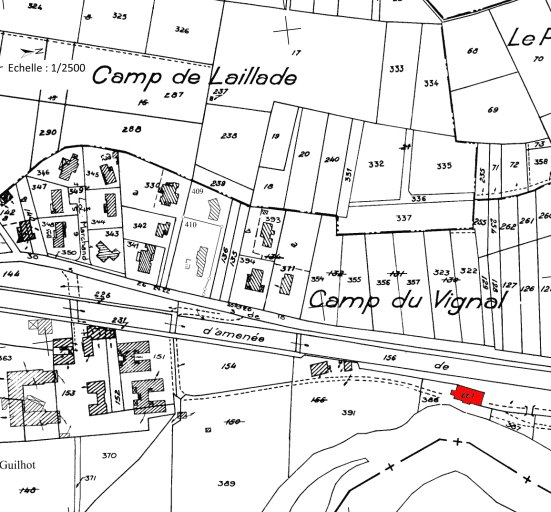Ancienne forge catalane dite de Guilhot
Désignation
Dénomination de l'édifice
Forge catalane
Précision sur la dénomination de l'édifice - hors lexique
Ancienne forge catalane
Appellation d'usage
Dite de Guilhot
Titre courant
Ancienne forge catalane dite de Guilhot
Localisation
Localisation
Occitanie ; Ariège (09) ; Benagues
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Communauté de communes du Pays de Pamiers
Canton
Pamiers-ouest
Lieu-dit
Guilhot
Références cadastrales
1981 B 227, 386, 387
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
Isolé
Nom de l'édifice
Site industriel
Références de l'édifice de conservation
IA09000367
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
1er quart 19e siècle
Année(s) de(s) campagne(s) de construction
1823
Commentaires concernant la datation
Daté par source
Personnalités liées à l'histoire de l'édifice
Thonel d'Orgeix Jean-François Joseph, Marquis de (maître de forges)
Description historique
La création de la forge catalane de Guilhot est étroitement liée à la famille de Thonel d'Orgeix, propriétaire du château de Benagues. Elle se situe dans la tradition des forges ariégeoises de l'Ancien Régime, dirigées pour la majorité par des aristocrates, grands propriétaires de forêts, tel Alexandre-Joseph de Thonel d'Orgeix, maître de forges en Pays de Foix, sur sa seigneurie d'Orgeix et sur Orlu. Les forges de Guilhot sont nées en 1823 sous l'impulsion de son fils Jean-François-Joseph. Né en 1783, il épouse en 1810 Marie-Antoinette de Vergniès, descendante de la famille Vergniès, autre famille importante de maîtres de forges du Vicdessos, qui lui apporte le château de Guilhot. En mars 1820, il demande l'autorisation de construire à Guilhot une forge à la catalane comportant un foyer et un martinet. La forge est prévue au point de rencontre des "deux grandes routes de Pamiers et de Mirepoix, en contact avec toutes les forêts dans un rayon de deux à trois lieux", permettant un accès aisé pour le minerai de fer de Rancié. Le plan du cadastre napoléonien de 1827 indique un chemin d'accès depuis le château vers la forge, plus au nord, en longeant la berge de l'Ariège. La forge fonctionne en 1823. A cette date, le marquis demande l'autorisatrion de construire un deuxième feu et un deuxième martinet, autorisation accordée en 1825. Les forges de Guilhot consommeront non seulement le charbon des bois de leur propriétaire mais celui d'autres forêts du secteur de Pamiers et de Mirepoix. La production correspond à deux qualités de fer, "fer dur ou acier, et fer mol ou doux", vendu à des marchands de Toulouse. Les forges occupent alors quatre maîtres, deux pique-mines et deux valets apprentis. Le site des forges est connu par le plan du cadastre napoléonien de 1827 ainsi que par les plans de construction de la forge déposés en 1820 par le Marquis d'Orgeix. L'activité se développe jusqu'en 1837-38, avant de retomber et de décliner dès 1840. En 1846, les forges sont mentionnée comme "en chômage ou abandonnées". Elles seront affermées par la marquise en 1851. Affaiblies par la concurrence progressive des hauts fourneaux, les forges de Guilhot, comme les autres forges de l'Ariège, vont disparaître. Le Domaine de Guilhot est vendu en 1868. L'activité métallurgique se poursuivra sur le site du Vignal. La forge disparaît avec l'inondation de 1897.
Description
Commentaire descriptif de l'édifice
Le site de l'ancienne forge à la catalane disparue de Guilhot s'étend sur la rive gauche de l'Ariège, sur la partie extérieure du méandre située entre le cours de la rivière et la route (R.D. n° 11) qui va de Saint-Jean-du-Falga à Rieux-de-Pellepport. Ce méandre était, du temps de la forge, beaucoup moins accusé qu'il ne l'est aujourd'hui, et suivait vers le sud une courbe plus ample qui jouxtait le château à son angle nord-est. D'après le plan déposé, la forge comportait un bâtiment principal parallèle à la rivière, complété aux angles par deux bâtiments plus modestes disposés en équerre, l'ensemble formant un plan en U ouvert sur l'Ariège. L'énergie hydraulique était fournie par un canalet en provenance du sud, branché en amont du château de Guilhot sur une digue d'alimentation perpendiculaire à l'Ariège. Ce canalet, après avoir traversé la propriété du château, venait remplir un grand bassin-réservoir visible sur le plan napoléonien contre le côté ouest du bâtiment principal. L'extrémité opposée du bassin aboutissait à une chute d'eau qui permettait de mettre en mouvement deux roues à aubes placées parallèlement, entre les deux salles de forge situées de part et d'autre. Chaque roue était reliée à un système d'arbres de transmission placés dans chaque salle, capables de mettre en oeuvre la frappe du marteau. Il ne reste aucun vestige des deux forges et du martinet. Seule une laiterie, réimplantée sur le site, subsiste à l'état de ruines. On relève sur place quelques traces de l'ancien circuit hydraulique, le fossé de l'ancien canal d'amenée comblé et le canal de fuite ensablé, à peine discernable dans un taillis épais.
État de conservation (normalisé)
Vestiges
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
Propriété privée
Références documentaires
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2002
Copyright de la notice
(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées
Date de rédaction de la notice
2003
Noms des rédacteurs de la notice et du dossier
Bonhôte Jérôme ; Cantelaube Jean ; Fournier Claire ; Claeys Laurent
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
Sous-dossier
Adresse du dossier Inventaire
Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47