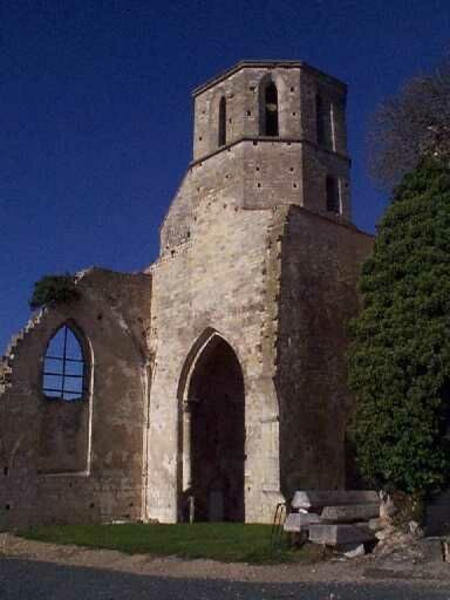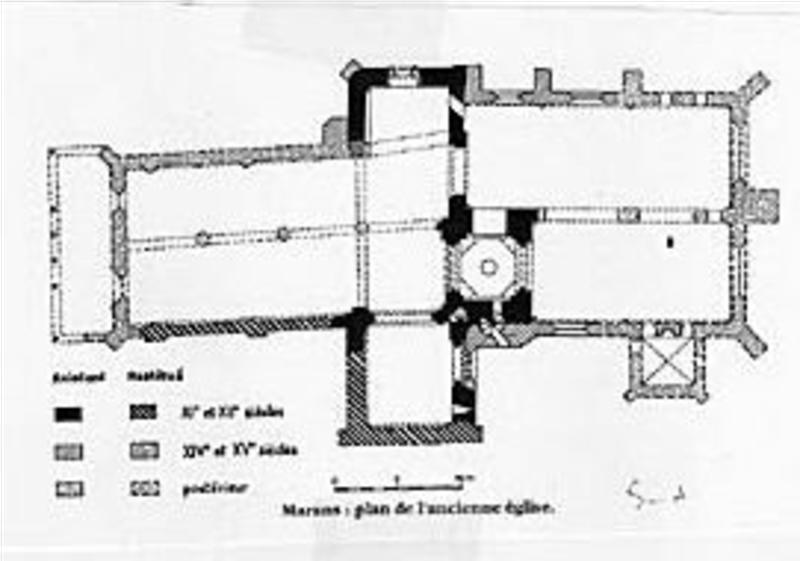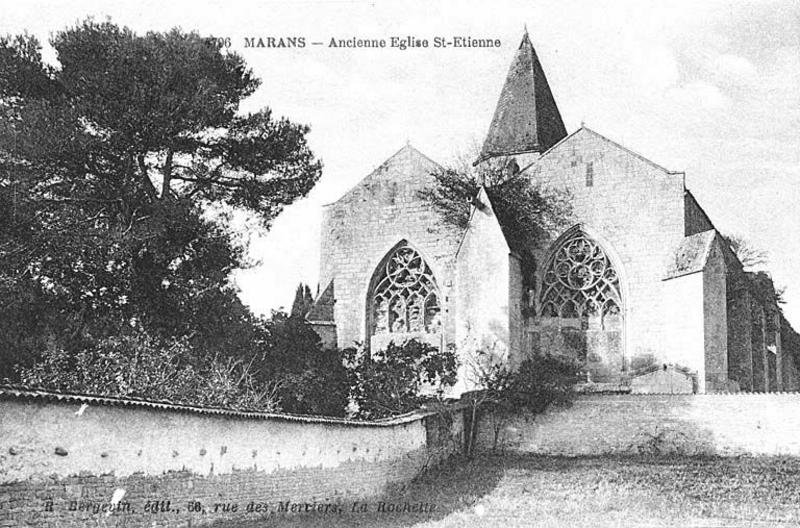Prieuré Saint-Etienne
Désignation
Dénomination de l'édifice
Prieuré
Vocable - pour les édifices cultuels
Saint-Etienne
Titre courant
Prieuré Saint-Etienne
Localisation
Localisation
Nouvelle-Aquitaine ; Charente-Maritime (17) ; Marans ; place Saint-Christophe
Adresse de l'édifice
Saint-Christophe (place)
Références cadastrales
1995 AH 312
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
En ville
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
11e siècle ; 2e moitié 12e siècle ; 4e quart 14e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle ; 17e siècle
Siècle de campagne secondaire de consctruction
2e quart 20e siècle
Année(s) de(s) campagne(s) de construction
1605
Commentaires concernant la datation
Daté par travaux historiques
Auteur de l'édifice
Commentaires concernant l'attribution de l'édifice
Attribution par source
Description historique
Ancien prieuré dépendant de l'abbaye Saint-Pierre de Maillezais et probablement construit au cours du 11e siècle. La construction se poursuit au 12e siècle, date de la base du clocher et des chapiteaux des colonnes (2e moitié du 12e siècle). A la fin du 14e et au 15e siècles, l'église subit quelques transformations : construction de la tour octogonale du clocher et de la vis qui le dessert ; agrandissement d'un vaisseau, en largeur, de la nef et du choeur (chevet plat double). Pendant les guerres de Religion, l'édifice fut pillé et endommagé (effondrement des voûtes). Le rétablissement de l'église commence dès le 17e siècle (1605, réfection du clocher) , mais les voûtes ne sont pas reconstruites et sont remplacées par un plafonds en lambris, alors que des colonnes ont été installées pour diviser la nef. Pendant la Révolution, l'église est utilisée comme temple de la Raison. Des réparations sont envisagés dès l'an IX et sont confiées à l'entrepreneur Pierre Meunier. En 1845, l'architecte Brossard dresse les devis de travaux d'urgence et de sauvegarde de l'édifice. Cependant, une lettre du maire au préfet, datée de 1845, signale que l'avis du conseil de fabrique et de la commune est que cette église ne doit pas être conservée car elle se trouve en dehors de la ville. Même chose en 1885, la fabrique préfère édifier une nouvelle église en centre ville. Une délibération du conseil municipal de 1905 indique l'état de délabrement de l'édifice puisqu'il est signalé qu'une quantité importante de matériaux pourrait servir aux besoins de la ville. D'anciennes photographies présentent l'état général de l'église avant sa démolition. Après le classement du clocher en 1921, la municipalité a entrepris, dès 1925, la démolition de cet édifice tout en réservant la partie classée : les matériaux ont été récupérés et adjugés à des entrepreneurs, les fenêtres du chevet ont été vendues à une personne de Paris. La porte de la sacristie, ornée d'un bas-relief du Repentir de Saint-Pierre, a été déposée au musée de la commune.
Description
Matériaux du gros-œuvre
Calcaire ; pierre de taille
Matériaux de la couverture
Tuile creuse
Description de l'élévation intérieure
3 vaisseaux
Typologie du couvrement
Coupole à trompes
Typologie de couverture
Toit en pavillon
Emplacement, forme et structure de l’escalier
Escalier dans-oeuvre : escalier en vis, en maçonnerie
Commentaire descriptif de l'édifice
Ne reste de l'édifice que le clocher, dont le rez-de-chaussée est couvert par une coupole sur trompes surmontée d'une tour octogonale, autrefois couverte d'une flèche et actuellement d'un toit en pavillon en tuile creuse. Les trompes de la coupole retombent sur des colonnes aux chapiteaux romans historiés. L'escalier en vis dans-oeuvre et une petite partie de l'élévation sud (un contrefort et une baie) sont conservés également. Le bras nord du premier édifice est encore visible, une partie du transept sud aussi (l'élévation est, pour laquelle on remarque une ancienne baie murée) , ainsi que l'arcade qui menait de la nef au transept.
Technique du décor des immeubles par nature
Sculpture
Indexation iconographique normalisée
Palmette ; feuillage ; animal fabuleux ; tête : homme ; pointe de diamant ; ornement à forme géométrique
Description de l'iconographie
Série de chapiteaux romans au niveau des colonnes de la tour du clocher : animaux affrontés, animaux fantastiques évoluant parmi du feuillage, au nord-ouest un chapiteau est sculpté de palmettes et au sud est une tête d'homme barbu. Des motifs géométriques ornent les tailloirs des chapiteaux (notamment des pointes de diamant).
État de conservation (normalisé)
Vestiges
Protection et label
Date et niveau de protection de l'édifice
1921/11/10 : classé MH
Intérêt de l'édifice
À signaler
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
Propriété publique
Références documentaires
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2002
Copyright de la notice
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
Date de rédaction de la notice
2002
Noms des rédacteurs de la notice et du dossier
Carpentier Aline
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
Dossier individuel
Adresse du dossier Inventaire
Région Nouvelle-Aquitaine - Service du Patrimoine et de l’Inventaire, site de Poitiers - 102, Grand'Rue - 86020 Poitiers - 05.49.36.30.07