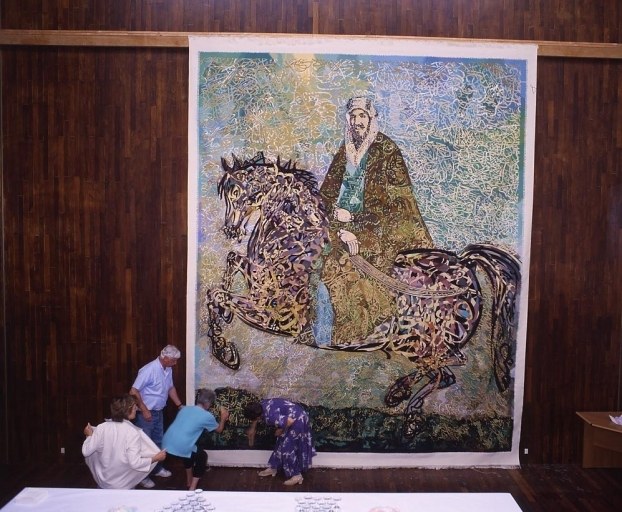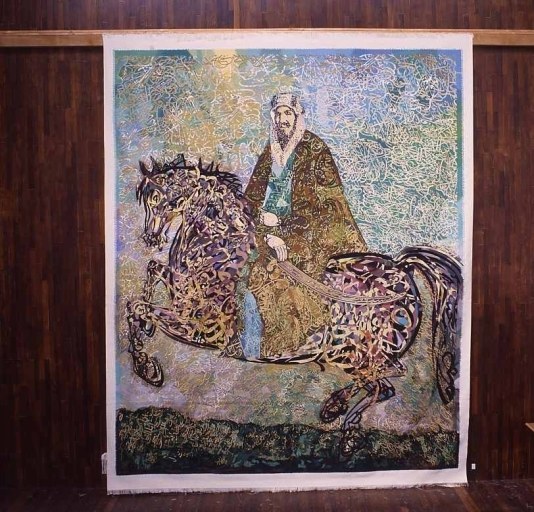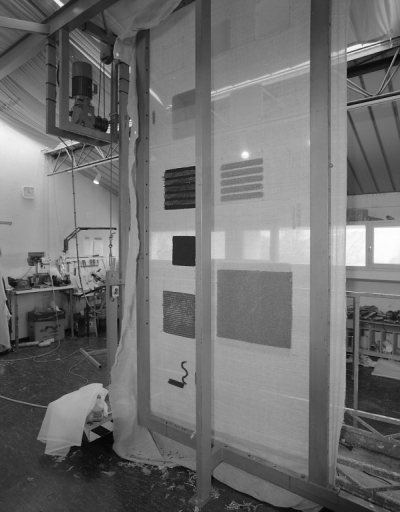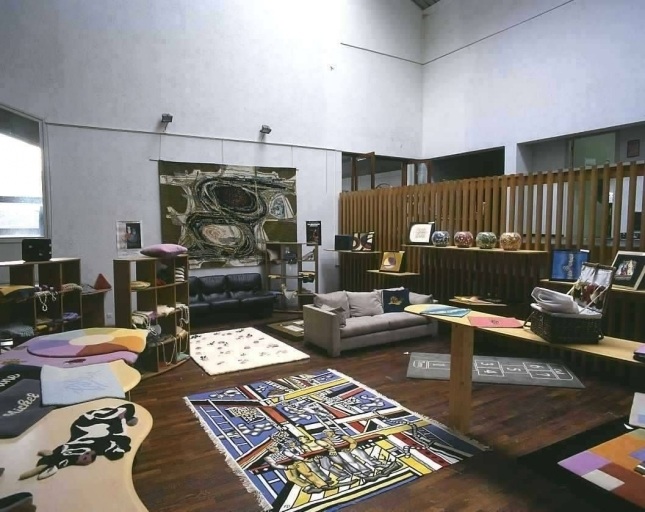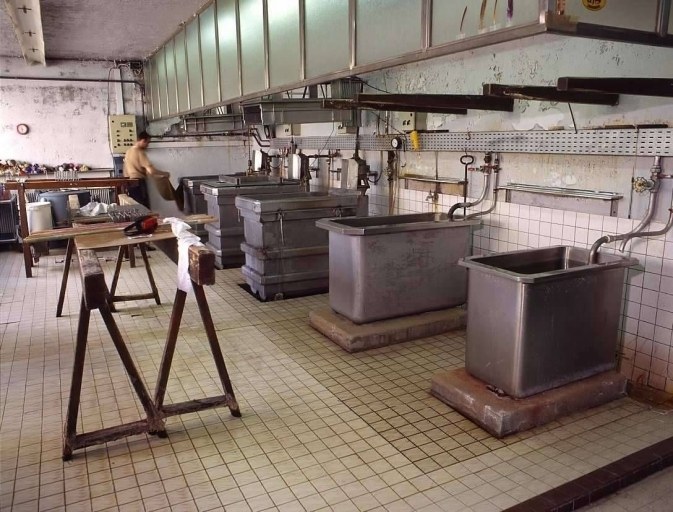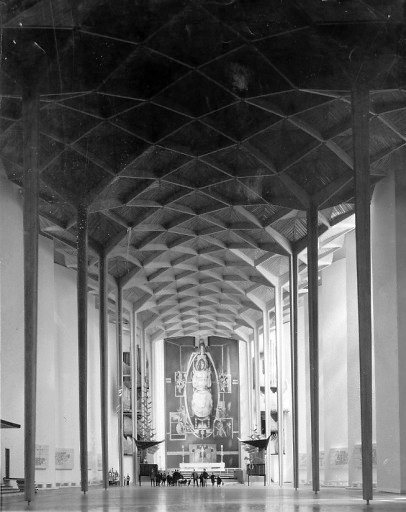Atelier de tapissier et tissage (usine de tapis) dits les ateliers Pinton
Désignation
Dénomination de l'édifice
Atelier ; tissage
Genre du destinataire
De tapissier
Précision sur la dénomination de l'édifice - hors lexique
Usine de tapis
Appellation d'usage
Les ateliers Pinton
Titre courant
Atelier de tapissier et tissage (usine de tapis) dits les ateliers Pinton
Localisation
Localisation
Nouvelle-Aquitaine ; Creuse (23) ; Felletin ; 9 rue Préville
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Felletin (commune)
Adresse de l'édifice
Préville (rue) 9
Références cadastrales
2003 AM 692, 792
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
En ville
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
3e quart 20e siècle
Année(s) de(s) campagne(s) de construction
1973
Commentaires concernant la datation
Daté par source
Auteur de l'édifice
Commentaires concernant l'attribution de l'édifice
Attribution par source
Description historique
La société J. Chateauvert et O. Pinton, ayant pour objet la fabrication et la vente des tapis dits tapis et tapisserie d'Aubusson, est créée le 1er février 1903. Elle est issue de l'alliance d'un dessinateur et d'un représentant de commerce (membre d'une famille de tapissiers à Aubusson). Elle s'installe 5 rue Feydeau dans les ateliers d'Hippolyte et Auguste Brunaud qui sont progressivement agrandis (cf. notice IA23000319). Parallèlement, l'entreprise développe les activités d'une teinturerie proche du pont des Malades, située sur la commune voisine de Saint-Quentin-la-Chabanne. Vers 1930, la manufacture alors appelée Pinton frères travaille 1800 kg de laine peignée par an, auxquels s'ajoutent des ballots de soie et de coton, pour produire 2500 kg de tapis et tapisserie dont 1300 kg sont destinés à l'export (aux Etats-Unis par exemple). Pour cela, une centaine de personnes travaillent à Felletin à domicile ou à la manufacture. Vers 1968, un descriptif des effectifs permet d'envisager la diversité des corps de métiers présents dans la manufacture : 68 liciers, 14 apprentis-liciers, 5 couseuses, 4 repriseuses, 7 bobineurs, 1 dessinateur, 2 coloristes (cartonniers) , 3 teinturiers et 2 employés de bureaux, soit 102 personnes. La société installe à Paris, son siège social auquel est associé un bureau de vente, 9 rue du Sentier vers 1920 et 36 rue des Jeûneurs vers 1950-1960, tous deux dans le 2e arrondissement, au coeur d'un quartier dévolu aux activités textiles. Dès la première moitié du 20e siècle, les grands magasins (comme les Galeries Lafayette) constituent un débouché essentiel de la production. Cette dernière est caractérisée par une volonté de collaborer avec des artistes contemporains novateurs et influents (comme Sonia Delaunay ou Vasarely) , de réfléchir à la transcription du travail pictural en tapisserie et enfin, de motiver des challenges techniques comme par exemple le tissage en 1962, de la plus grande tapisserie du monde (22 m x 12 m) pour la cathédrale de Coventry en Angleterre. Entre 1955 et 1960, Pinton frères achète la manufacture Rivières des Borderies située 8 rue Quinault (cf. notice IA23000438) et y développe ses productions. L'activité est dispersée entre les deux sites felletinois et la fabrication à domicile ; ainsi, un besoin de rationalité et la nécessité de rassembler la confection au vu d'une conjoncture un peu chaotique, motive la création d'un nouveau bâtiment. Ce dernier, dessiné par Jean Willerval, architecte titulaire du Grand prix national de l'architecture en 1975, est inauguré en 1973. Il réunit principalement les bureaux (siège social de la société) , un espace d'exposition et de vente, un atelier de teinture, deux ateliers de tissage de tapisserie, un atelier de tissage de tapis auquel est subordonné un atelier de finition et enfin, un magasin de laines avec un espace dévolu au cartonnier. Les ateliers Pinton qui, des années 1980 à 2002, ont été associés à la société Les Fuses, travaille aujourd'hui de manière indépendante, dans le respect de la tradition tapissière aubussonnaise tout en se tournant vers de nouvelles techniques (recherche de délais de production plus courts sans perte qualitative). En effet, si la manufacture produit toujours des tapisseries de basse lisse et des tapis ras, elle développe par ailleurs et ce, depuis 1992, la fabrication de tapis tufté (le velours du tapis est implanté dans la chaîne grâce à un pistolet). Les ateliers Pinton emploient encore 45 personnes en 1980, aujourd'hui ils sont 15 à perpétuer la tradition.
Description
Matériaux du gros-œuvre
Béton
Matériaux de la couverture
Matériau synthétique en couverture
Description de l'élévation intérieure
1 étage carré
Typologie de couverture
Toit à un pan
Commentaire descriptif de l'édifice
L'ensemble architectural dessiné par Jean Willerval comprend trois corps de bâtiments de taille différente, juxtaposés les uns contre les autres. Couvert d'un toit à un pan en matériau synthétique, rappelant les toitures en shed caractéristiques des constructions industrielles de la 2e moitié du 19e siècle et de la 1ère moitié du 20e siècle, l'usine présente une facture moderniste. Les ouvertures de taille importante, séparées par des bandeaux de couleur jaune, sont concentrées sur les façades nord (permettant une luminosité moins soumise aux aléas de l'ensoleillement) et insérées à la toiture. L'enduit blanc, couvrant tout l'ensemble architectural, contraste avec les éléments de couleur jaune et forme ainsi une rythmique (évocation du néoplasticisme). Les ateliers et les différents espaces intérieurs sont articulés autour d'un escalier rampe sur rampe, en bois, et une salle d'exposition à éclairage zénithal.
Protection et label
Référence aux objets conservés
IM23001668 ; IM23001653
Intérêt de l'édifice
À signaler
Observations concernant la protection de l'édifice
Felletin semble être le berceau de la tapisserie creusoise, les ateliers Pinton sont aujourd'hui les seuls à perpétuer cette tradition. De plus, ils sont installés dans un bâtiment contemporain. Ce dernier reflète les réflexions menées sur les nécessités de production. Il contribue par ailleurs, à valoriser l'image d'un savoir-faire séculaire tout en l'insérant dans des perspectives modernistes. L'unicité de ce programme architectural (à Felletin mais aussi à Aubusson) souligne l'intérêt que suscite ce bâtiment.
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
Propriété privée
Références documentaires
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2004
Copyright de la notice
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Felletin
Date de rédaction de la notice
2005
Noms des rédacteurs de la notice et du dossier
Lazaj Jehanne
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
Dossier individuel
Adresse du dossier Inventaire
Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de la Région - Service du Patrimoine et de l’Inventaire, site de Limoges - 27, boulevard de la Corderie - CS 3116 - 87031 Limoges Cedex 1 - 05 55 45 19 00