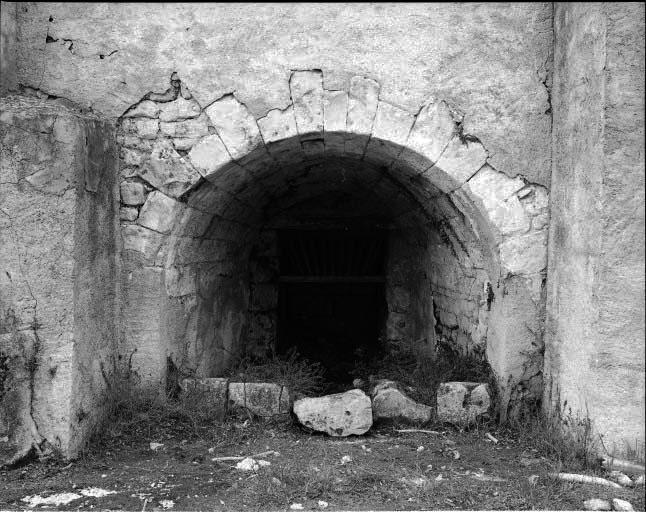Fours à chaux
Désignation
Dénomination de l'édifice
Four à chaux
Appellation d'usage
Maison Paul Ricard
Titre courant
Fours à chaux
Localisation
Localisation
Centre-Val de Loire ; Indre-et-Loire (37) ; Trogues
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Ile-Bouchard (L')
Lieu-dit
Rolandière (la)
Références cadastrales
1831 B1 209 ; 1964 AH 35 à 46 ; 1964 AE 3 à 9
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
En écart
Partie constituante non étudiée
Magasin industriel ; hangar industriel ; maison ; écurie ; voie ferrée
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
19e siècle
Année(s) de(s) campagne(s) de construction
1858 ; 1882 ; 1891
Commentaires concernant la datation
Daté par source
Auteur de l'édifice
Description historique
Deux fours à chaux ont été construits en 1858 sur une terre qui appartenait alors à la veuve Tiffeneau-Roy de Sainte-Maure, et ce avec autorisation préfectorale accordée le 4 décembre 1857 à Aimé Legris, négociant. Sur le site passé plus tard à Charles Emmanuel Legris, négociant à Nantes, trois autre fours à chaux ont été construits en 1882 ainsi que deux magasins et hangars, en 1865 une maison, et en 1891 un autre magasin et hangar. L'exploitation des fours était confiée à un régisseur ou un directeur ; en 1861 à Vignal Jacques, en 1866 à Fariants Charles, en 1876 à Lagerbe Pierre, en 1886 à Pasquier Armand. En 1892, le site passe à Desfontaines-Girard Léon, fabricant de chaux et un sixième four est construit en 1893, puis un bureau en 1901 et un embranchement particulier au chemin de fer en 1907. Le directeur de l'établissement en 1896 est Legrand Alfred ; en 1906 Archain Alexandre et en 1911 Sellier. En 1914 l'usine passe à Picard Paul, cabaretier, et en 1928 à Pailheret-Picard Félix. Le 30 janvier 1928 sont déposés les statuts de la S.A. Maison PAul Picard. Cette société, qui a pour objet la reprise et l'exploitation des anciens établissements industriels Paul Picard, fabrication de chaux et agglomérés, commerce des matériaux et toutes et toutes exploitations connexes, est créée pour une durée de 99 années, son siège social étatnt à Rennes.En 1921 et 1931, l'usine est dirigée respectivement par Proust Edmont et Huger Auguste. L'activité chaufournière a cessé sur le site de la Rolandière au début des années 1940 et en 1950 un établissement agricole y a été installé. Ce dernier, qui n'a pas été exploité longtemps, a laissé la place à un terrain de camping, aménagé dans les anciennes carrières, et des maisons individuelles sur le site proprement dit. En 1858 on relève sur le site 10 ouvriers ; une vingtaine en 1863, 25 en 1882 qui perçoivent un salaire journalier de 3, 50 à 4 francs. De 25 à 30 ouvriers en 1883 pour un salaire de 3 à 4 francs ; enfin une dizaine en 1831. Le directeur, ou régisseur de l'usine et 2 ou 3 ouvriers seulement étaient logés sur le site. L'exploitation des carrières n'était pas sans danger et les accidents par chutes de pierre ou éboulements assez fréquents, quoique moindre qu'en carrières souterraines. Le 20 septembre 1893 s'est produit un accident mortel.
Description
Matériaux du gros-œuvre
Moellon ; enduit ; pierre de taille
Typologie du couvrement
Canonnière ; voûte en berceau plein-cintre
Source de l'énergie utilisée par l'édifice
Énergie thermique ; produite sur place
Commentaire descriptif de l'édifice
Batterie de six fours à chaux à feu continu et flamme courte. La capacité totale des deux premiers fours était de 40 m3 et celle des quatre autres de 120 m3, soit environ 20 m3 chacun pour les premiers et 30 m3 pour les seconds. Ces fours permettaient la cuisson de pierre à chaux destinée à la fabrication de chaux hydraulique naturelle et de briques, agglomérées et pressées. La matière première était extraite de carrières à ciel ouvert, situées au nord-est et à l'est de l'usine. Elle était initialement transportée par charrettes puis par des wagonnets. L'extraction était manuelle. La batterie a été réalisée en trois tranches, deux fours en 1858, 3 en 1882, et 1 en 1893. Les fours des 1ères et 2èmes tranches sont conservés tandis que celui de la 3ème tranche a sa cuve comblée et son embrasure de défournement obstruée. Les gueulard des fours 1 à 5 ont été recouverts d'une dalle en béton tandis que les embrasures bien conservées sont d'accès libre. Les murs de la batterie sont en moellon ébauché et enduit, avec chaîne d'angle en pierre de taille. Le site était situé à 80 m au sud-ouest de la Vienne. Il était équipé d'un moteur thermique et d'un générateur d'électricité, de broyeurs et de presses. La surface totale à l'exclusion des carrières est de 25900 mètres carrés. La surface bâtie est d'environ 1200 mètres carrés.
État de conservation (normalisé)
Vestiges
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
Propriété privée
Références documentaires
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2001
Copyright de la notice
© Inventaire général
Date de rédaction de la notice
2001
Noms des rédacteurs de la notice et du dossier
Thomas Jacques ; Lainé Martine
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
Dossier individuel
Adresse du dossier Inventaire
Région Centre-Val de Loire - Service régional de l'Inventaire - 6 rue de la Manufacture 45000 Orléans – 02.38.70.25.06