Ministère
de la Culture
POP | Plateforme ouverte du patrimoinecouvent de dominicains, actuellement école ; église paroissiale du Sacré-Coeur
couvent de dominicains, actuellement école ; église paroissiale du Sacré-Coeur

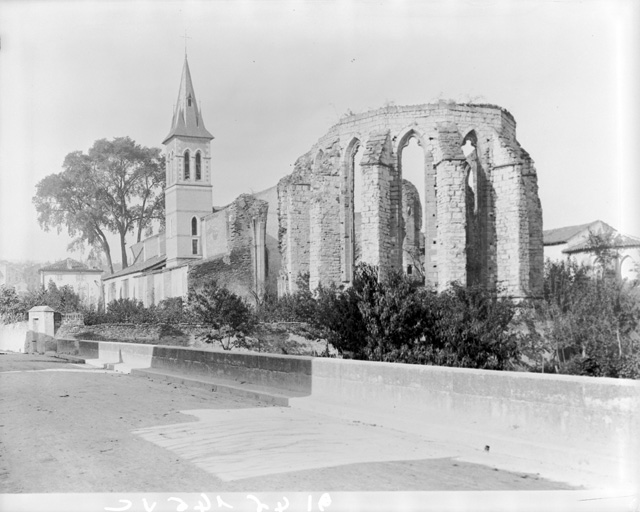
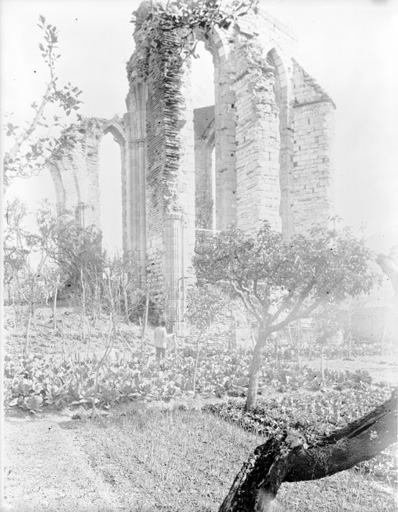

Référence de la notice
IA46000114
Nom de la base
Patrimoine architectural (Mérimée)
Producteur
Inventaire
Date de création de la notice
24 décembre 2018
Date de dernière modification de la notice
31 janvier 2025
Rédacteur de la notice
Scellès Maurice
Mentions légales
(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Ville de Cahors
Désignation de l'édifice
Titre courant
couvent de dominicains, actuellement école ; église paroissiale du Sacré-Coeur
Producteur
Inventaire
Dénomination de l'édifice
couvent ; église paroissiale
Qualité des personnes pour qui l'édifice a été construit ou transformé
de frères prêcheurs
Vocable, pour les édifices cultuels
Sacré-Coeur
Destination actuelle de l'édifice
actuellement école
Localisation au moment de la protection ou de l'étude
Localisation
Occitanie ; Lot (46) ; Cahors
Aire d'étude pour le domaine de l'Inventaire
Cahors faubourg
Références cadastrales
2001 BM 57, 63, 131
Milieu d'implantation pour le domaine de l'Inventaire
en ville
Partie constituante non étudiée
cloître
Historique de l'édifice
Siècle de campagne principale de construction
Description historique
Appelés à Cahors en 1226, les frères prêcheurs, dits aussi "dominicains" ou "jacobins", ont d'abord occupé l'église Saint-Géry, faisant construire à proximité les bâtiments claustraux nécessaires. Une trentaine d'années plus tard, Arnaud Béraldi, bourgeois de Cahors (et seigneur de Cessac en 1260), achète un terrain situé à Cabessut, près de l'église paroissiale Saint-Pierre, pour y établir un nouveau couvent dont il finance la construction et où il est enterré à sa mort en 1261. Les dominicains s'y installent en 1264, et l'église est probablement achevée ou en voie de l'être à cette date. L'église Saint-Pierre que l'évêque Barthélemy de Roux leur avait donnée, avec toutes ses dépendances, en 1260 a dû conserver longtemps sa fonction d'église paroissiale.£La première église conventuelle était, semble-t-il, une construction relativement modeste. Le couvent attire les dons des bourgeois et des nobles qui demandent à y être enterrés et font édifier des chapelles peut-être dès la fin du 13e siècle. Mais c'est surtout à l'entourage du pape Jean XXII (1316-1334), dont le père était inhumé dans l'église, qu'il faut attribuer l'agrandissement du choeur. Le nouveau chevet est fondé par Gaucelme de Jean, créé cardinal en 1317, le bras droit du transept par Pierre de Via, beau-frère du pape,, décédé en 1337 ; Guillaume de Labroue, dominicain nommé évêque de Cahors par Jean XXII en 1317 et bibliothécaire du pape, lègue tous ses biens au couvent, dont 200 florins sont employés aux travaux de l'église après sa mort en 1324. La construction du nouveau chevet et du transept doit donc se situer entre 1317 et 1337. Sans doute les travaux ont-ils aussi concerné la nef, mais seule une étude archéologique complète de l'édifice, jamais réalisée, permettrait de préciser l'état du 14e siècle à travers les nombreux remaniements ultérieurs. Situé hors les murs, le couvent a en effet en partie détruit par les protestants en 1580, puis il a été ravagé par un incendie en 1609 ; vendu comme Bien national à la Révolution , il a été occupé par une verrerie jusqu'en 1848. En 1851, les terrains et les bâtiments sont donnés au diocèse et une nouvelle église paroissiale dédiée au Sacré-Coeur est établie dans les ruines de la nef de l'église conventuelle, tandis que les soeurs de Vaylats installent une école dans les bâtiments conventuels, faisant restaurer la chapelle du chapitre.
Description de l'édifice
Matériaux du gros-œuvre
calcaire ; pierre de taille ; brique
Matériaux de la couverture
tuile creuse ; ardoise
Typologie de plan
plan en croix latine
Description de l'élévation intérieure
1 vaisseau
Typologie du couvrement
voûte d'ogives
Typologie de la couverture
toit à longs pans ; croupe polygonale
Commentaire descriptif de l'édifice
Peu après le pont de Cabessut, en bordure de la rue des Jacobins, les ruines du chevet, malheureusement envahies par la végétation, donnent une première idée des dimensions de l'ancienne église des dominicains. L'abside polygonale et la partie droite qui la précède sont épaulées par des contreforts entre lesquelles ouvrent de très hautes fenêtres qui ont conservé quelques vestiges de leurs réseaux de pierre. Si les parements extérieurs sont en pierre de taille, les élévations intérieures sont en brique ; on y distingue encore les arrachements des voûtes.£La grande brèche entre le chevet et la nef en partie réoccupée par l'église paroissiale correspond au transept. Un escalier pris sur l'épaisseur du mur ouest du bras nord donnait sans doute accès au clocher. La première travée de la nef, avant le mur de fermeture de l'église paroissiale, montre des traces d'arcs formerets antérieurs à la construction du transept, et qui sont donc les vestiges les plus évidents de la première église.£La nef avait au moins deux travées de plus vers l'ouest, et comptait donc un minimum de sept travées bordées de chapelles, au nord comme au sud, toutes voûtées d'ogives. La moindre profondeur des chapelles nord tient sans doute à la présence des bâtiments conventuels. Deux de leurs voûtes se sont affaissées et ont dû être étayées à la suite de la suppression, dans les années 1970, des murs qui séparaient les chapelles, et qu'il faudrait aujourd'hui rétablir. Les maçonneries mises à nu montrent plusieurs phases de reprises dont l'analyse archéologique serait nécessaire à la compréhension de l'évolution de l'édifice.£Des bâtiments conventuels du Moyen Age ne semble subsister que les vestiges de la chapelle de la salle du chapitre, en partie reconstruite au 19e siècle et largement dénaturée par les aménagements des années 1970.
Technique du décor porté de l'édifice
sculpture
Indexation iconographique
ornement végétal ; armoiries
Description de l'iconographie
Armoiries de Gaucelme de Jean (?) sur la clef de voûte de la chapelle située au nord du choeur actuel : (d'azur) à la bande (d'argent) accostée de deux cotices (d'or).
État de conservation
mauvais état ; envahi par la végétation
Date de l'enquête ou du récolement
1999
Statut juridique, intérêt, protection et label
Intérêt de l'édifice
à signaler
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
propriété de la commune ; propriété privée
Références documentaires
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
dossier individuel
Date de rédaction de la notice
2011
Mentions légales
(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Ville de Cahors
Sources complémentaires
Adresse de conservation et consultation du dossier
Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines£22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47

Référence de la notice
IA46000114
Nom de la base
Patrimoine architectural (Mérimée)
Producteur
Inventaire
Date de création de la notice
24 décembre 2018
Date de dernière modification de la notice
31 janvier 2025
Rédacteur de la notice
Scellès Maurice
Mentions légales
(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Ville de Cahors
Contactez-nousEnvoyer un courriel