Ministère
de la Culture
POP | Plateforme ouverte du patrimoineéglise paroissiale Saint-Geniès
église paroissiale Saint-Geniès
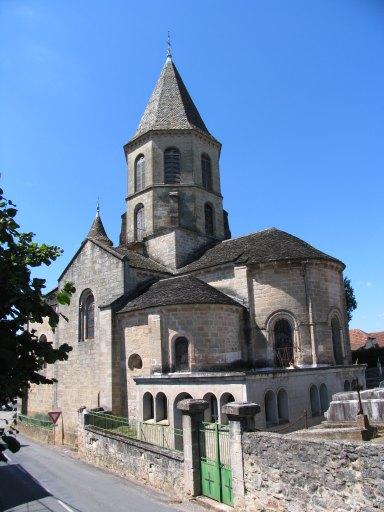

Référence de la notice
IA46100424
Nom de la base
Patrimoine architectural (Mérimée)
Producteur
Inventaire
Date de création de la notice
21 octobre 2015
Date de dernière modification de la notice
19 janvier 2022
Rédacteur de la notice
Séraphin Gilles ; Scellès Maurice
Mentions légales
(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Conseil départemental du Lot
Désignation de l'édifice
Titre courant
église paroissiale Saint-Geniès
Producteur
Inventaire
Dénomination de l'édifice
église paroissiale
Vocable, pour les édifices cultuels
Saint-Geniès
Localisation au moment de la protection ou de l'étude
Localisation
Occitanie ; 46 ; Aynac
Aire d'étude pour le domaine de l'Inventaire
Lot
Canton
Lacapelle-Marival
Références cadastrales
2005 0F02 404, 403, 1061, 1192
Milieu d'implantation pour le domaine de l'Inventaire
en village
Partie constituante non étudiée
cimetière
Historique de l'édifice
Siècle de campagne principale de construction
Siècle de campagne secondaire de construction
4e quart 18e siècle
Description historique
La première mention sûre de la paroisse n'est sans doute pas antérieure à 932 : à cette date, Aynac est le chef-lieu d'une vicairie et le comte de Rouergue et de Quercy, Raymond, recommande alors à l'un de ses vicomtes, Frotard, d'en faire don à l'abbaye de Beaulieu. Au 11e siècle, peut-être vers 1090, l'église est "restituée" par Hugues de Fayt au chapitre de la cathédrale de Cahors, et devient un prieuré, non conventuel, à la collation du chapitre, dont un chanoine est prieur d'Aynac. Aucun document ne renseigne la construction de l'édifice ou des travaux ultérieurs avant 1785, quand de grosses réparations sont effectuées à la suite de l'écroulement d'une partie des voûtes (Charrier, 2007, p. 49-50). En 1882, la nef est entièrement reconstruite en style néo-roman (Clary, 1986), avec une fausse-voûte en brique qui sera déposée en 1998, et le clocher est "surhaussé" (ou reconstruit ?). La voûte du bras nord du transept qui s'écroule en 1964 est refaite l'année suivante.£Si le chevet et le transept appartiennent dans leur ensemble à l'édifice roman, l'analyse archéologique (Charrier, 2007) montre que c'est toute l'élévation nord de l'absidiole nord et du bras du transept qui a été reconstruite à la fin du 18e siècle, et que l'angle sud-ouest du bras sud l'a été en 1882.£Le décor sculpté et les formes architecturales pourraient inviter à placer le chevet dans la seconde moitié du 12e siècle, plutôt que le premier quart, comme cela a pu être proposé (Charrier, 2007), le chantier ne s'achevant peut-être, avec le transept, qu'au début du 13e siècle.
Description de l'édifice
Matériaux du gros-œuvre
grès ; pierre de taille
Matériaux de la couverture
schiste en couverture ; ardoise
Typologie de plan
plan en croix latine
Description de l'élévation intérieure
1 vaisseau
Typologie du couvrement
voûte en berceau brisé ; cul-de-four
Typologie de la couverture
toit à longs pans ; croupe ronde ; toit à deux pans ; pignon découvert ; toit conique ; flèche polygonale
Commentaire descriptif de l'édifice
Le chevet, bâti en bel appareil de grès, se compose d'une abside précédée d'une travée droite à laquelle sont accolées deux chapelles, dont la partie semi-circulaire est également précédée d'une partie droite. Les trois fenêtres de l'abside prennent place entre les contreforts qui montent jusqu'à la corniche. Elles sont à ressaut et tore retombant par l'intermédiaire de chapiteaux en forme de bague, sans tailloir, sur des colonnettes de même section ; leurs archivoltes à billettes se prolongent en cordon, y compris sur les contreforts. Les mêmes formes ont été utilisées à l'intérieur pour les fenêtres et les passages qui mettent en communication les chapelles latérales et le choeur. Dans l'élévation sud de la travée droite de la chapelle sud, la fenêtre est remplacée par un oculus à ressaut.£Le couvrement des travées droites du choeur et de la chapelle sud est en berceau brisé, mais si l'arc doubleau de l'abside est de section rectangulaire, celui de la chapelle sud est en revanche un tore épais. L'importance des piles de la croisée du transept et le renforcement des arcs s'expliquent par la présence du clocher ; quant à la voûte d'ogives, à clef annulaire qui la couvre, ses voûtains en brique indiquent qu'il s'agit d'une fausse voûte, sans doute du 19e siècle. Le bras sud du transept conserve une porte à arc brisé dont l'arrière-voussure est en tas de charge, sans qu'il soit possible de dire s'il s'agit de l'état d'origine ou d'un aménagement plus tardif. Le décor sculpté, réparti sur les chapiteaux et les bases, est relativement homogène dans le choeur, les chapelles latérales et le pilier nord-ouest de la croisée où règnent en outre les cordons à billettes ou à damier. Des chapiteaux et tailloirs très différents apparaissent en revanche dans le pilier sud-ouest de la croisée, confortant l'hypothèse de deux phases de construction.
Technique du décor porté de l'édifice
sculpture
Indexation iconographique
scène biblique ; entrelacs ; ornement végétal ; ornement animal ; Jugement dernier ; scènes de l'ancien testament
Description de l'iconographie
A côté de décors végétaux, d'entrelacs et animaliers, quelques chapiteaux sont historiés, figurant Samson et le lion, un homme en proie à deux lions, et une scène non identifiée mettant en présence une chèvre et un âne face à un personnage agenouillé. Un fragment sculpté déposé représente des personnages sortant de leurs tombeaux et une âme dans une mandorle losangique emportée par deux anges, autour d'une croix inscrite dans une mandorle circulaire ornée de perles, qui permettent d'y reconnaître un Jugement dernier.
Date de l'enquête ou du récolement
2005
Statut juridique, intérêt, protection et label
Date et niveau de protection de l'édifice
1913/10/22 : classé MH
Précision sur la protection
Eglise : classement par arrêté du 22 octobre 1913
Intérêt de l'édifice
à signaler
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
propriété de la commune
Références documentaires
Typologie du dossier
dossier individuel
Date de rédaction de la notice
2005
Mentions légales
(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Conseil départemental du Lot
Sources complémentaires
Adresse de conservation et consultation du dossier
Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines£22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47

Référence de la notice
IA46100424
Nom de la base
Patrimoine architectural (Mérimée)
Producteur
Inventaire
Date de création de la notice
21 octobre 2015
Date de dernière modification de la notice
19 janvier 2022
Rédacteur de la notice
Séraphin Gilles ; Scellès Maurice
Mentions légales
(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Conseil départemental du Lot
Contactez-nousEnvoyer un courriel