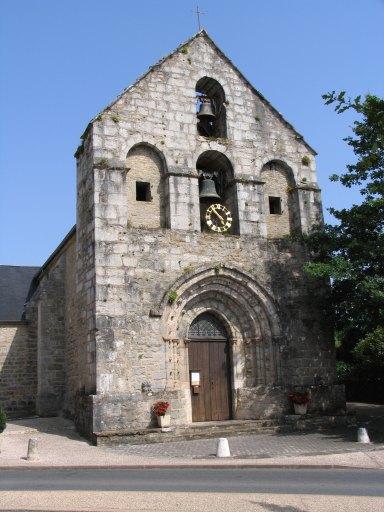Église paroissiale Saint-Blaise, prieuré de bénédictins
Désignation
Dénomination de l'édifice
Église paroissiale ; prieuré
Genre du destinataire
De bénédictins
Vocable - pour les édifices cultuels
Saint-Blaise
Titre courant
Église paroissiale Saint-Blaise, prieuré de bénédictins
Localisation
Localisation
Occitanie ; 46 ; Lavergne
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Lot
Canton
Gramat
Références cadastrales
2011 AD01 103
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
En village
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
4e quart 12e siècle (?) ; 4e quart 19e siècle
Année(s) de(s) campagne(s) de construction
1886
Commentaires concernant la datation
Porte la date
Auteur de l'édifice
Commentaires concernant l'attribution de l'édifice
Attribution par travaux historiques
Description historique
Edmond Albe (op. cit.) a pu établir que Lavergne était un prieuré dépendant de Védrennes (commune d'Egletons, en Corrèze), prieuré de l'abbaye bénédictine de La Chaise-Dieu (Haute-Loire), avant de dépendre au 17e siècle de l'abbaye de La Couronne et des chanoines réguliers de saint Augustin de Cahors. Des noms de prieurs sont connus à partir de 1314 et la mention du "sol du cloître" qui apparaît dans la documentation laisse penser qu'il s'agissait d'un prieuré conventuel. Les Valon, seigneurs du lieu, donnèrent sans doute les terres qui permirent la création du prieuré, sur la paroisse qui était rattachée à la mense de l'archiprêtre de Thégra, et Edmond Albe supposait que l'église pouvait être due à Bernard de Valon, abbé de La Chaise-Dieu vers la fin du 12e siècle. Le décor du portail s'inspire de celui du portail nord de la cathédrale de Cahors, daté vers 1150, mais il faut probablement situer la construction de l'église dans le dernier quart du 12e siècle. D'importants travaux ont été réalisés à la fin du 19e siècle (V. Rousset, op. cit.). Après un projet demandé à l'architecte Emile Toulouse en 1883, qui n'est pas réalisé, c'est l'architecte de l'arrondissement de Gourdon, A. Darnis, qui conduit les travaux. La nef, qui était charpentée, est couverte d'une fausse voûte en plein cintre et des contreforts sont ajoutés au nord et au sud, de nouvelles fenêtres sont créées, la chapelle nord est reconstruite et une chapelle symétrique est bâtie au sud ; jugé trop étroit, l'arc triomphal est rebâti, et les sépultures des Valon, qui se trouvaient dans le choeur, disparaissent. La date de 1886 est inscrite sur la sacristie.
Description
Matériaux du gros-œuvre
Calcaire ; tuf ; pierre de taille ; moellon
Matériaux de la couverture
Ardoise
Typologie de plan
Plan en croix latine
Description de l'élévation intérieure
1 vaisseau
Typologie du couvrement
Cul-de-four ; voûte en berceau plein-cintre ; fausse voûte en berceau plein-cintre
Typologie de couverture
Toit à longs pans ; croupe ronde
Commentaire descriptif de l'édifice
L'église romane se compose d'une nef unique et d'un chevet de même hauteur et de même largeur, formé d'une abside semi-circulaire précédée d'une travée droite dont l'articulation est marquée à l'extérieur par deux contreforts placés au droit de l'arc doubleau. Les contreforts, très peu épais, montent jusqu'à la corniche dont les modillons sont sculptés. La partie occidentale paraît n'être qu'incomplètement conservée : les épaississements des élévations latérales laissent penser que la façade s'achevait sur un clocher barlong, ouvert à l'est, la nef étant probablement couverte d'une simple charpente. L'élément principal de la façade occidentale est le portail, qui offre la particularité de faire évidemment référence au portail nord de la cathédrale de Cahors, dont il emprunte certains éléments du décor sculpté mais aussi l'alternance de pierres grises et blanches. Les piédroits sont posés sur un haut soubassement. A l'intérieur subsistent les vestiges d'une litre funéraire appliquée directement sur la pierre, avec les traces d'écus surmontés d'une couronne.
Technique du décor des immeubles par nature
Sculpture
Indexation iconographique normalisée
Tête d'homme ; homme ; ornement animal ; ornement végétal ; ornement géométrique
Description de l'iconographie
Les modillons de l'abside sont sculptés de têtes humaines ou animales ou de motifs végétaux ou géométriques, parfois placé dans un cadre qui peut être formé par une corde. Les voussures du portail sont ponctuées de têtes humaines, de personnages, et de motifs décoratifs très divers : fleurs, boules, têtes de clous...
Protection et label
Date et niveau de protection de l'édifice
1925/06/09 : inscrit MH
Intérêt de l'édifice
À signaler
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
Propriété de la commune
Références documentaires
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2006
Copyright de la notice
(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Conseil départemental du Lot
Date de rédaction de la notice
2011
Noms des rédacteurs de la notice et du dossier
Séraphin Gilles ; Scellès Maurice
Typologie du dossier
Dossier individuel
Adresse du dossier Inventaire
Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47