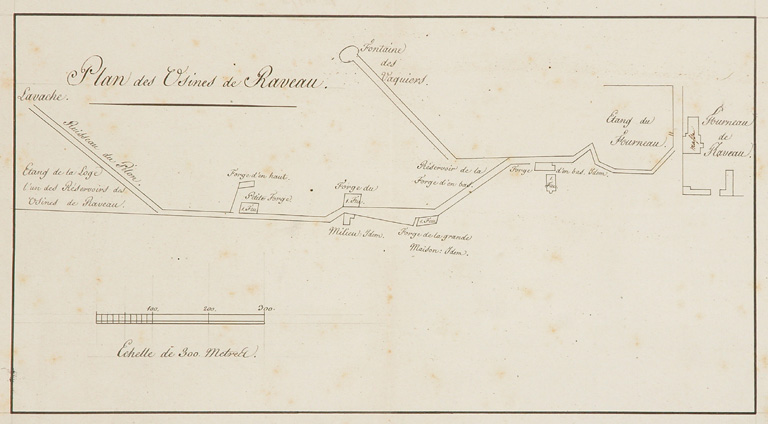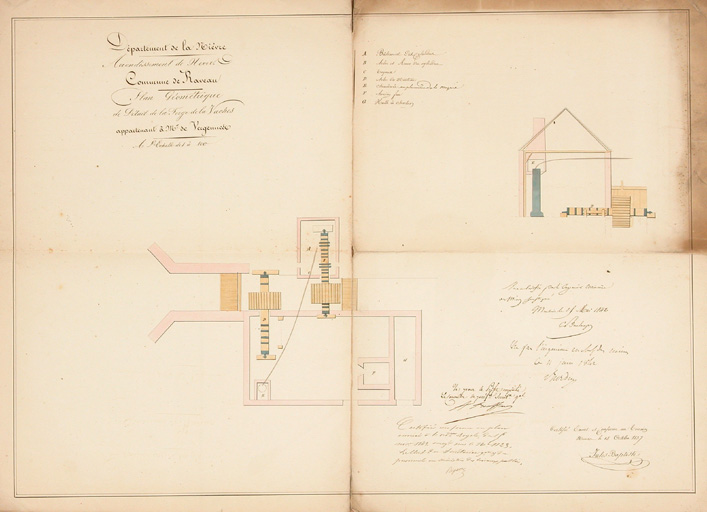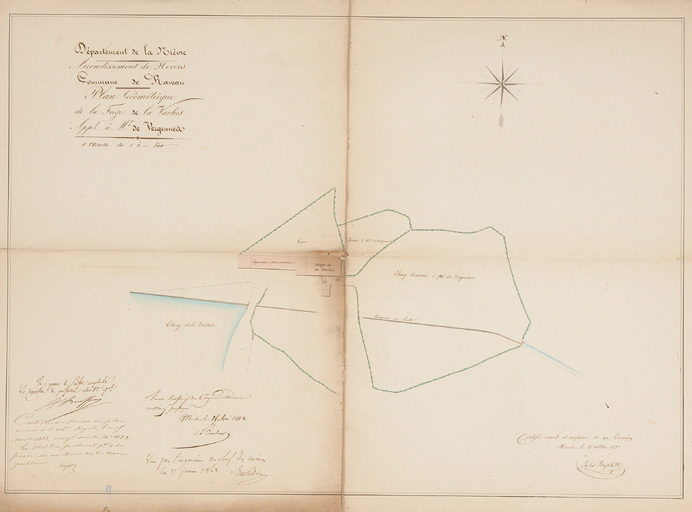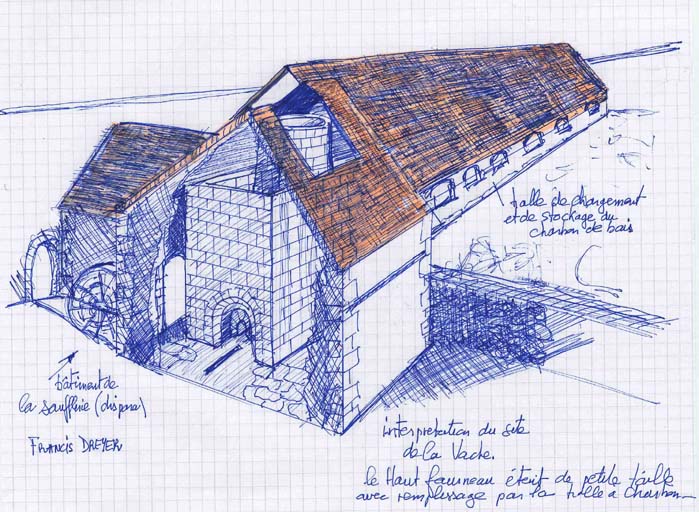Usine métallurgique dite les forges de la Vache, puis ferme, actuellement hôtel de voyageurs et maison
Désignation
Dénomination de l'édifice
Usine métallurgique
Appellation d'usage
Forges de la Vache
Destination actuelle de l'édifice
Ferme ; hôtel de voyageurs ; maison
Titre courant
Usine métallurgique dite les forges de la Vache, puis ferme, actuellement hôtel de voyageurs et maison
Localisation
Localisation
Bourgogne-Franche-Comté ; Nièvre (58) ; Raveau
Précision sur la localisation
Anciennement région de : Bourgogne
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Nièvre
Canton
La Charité-sur-Loire
Lieu-dit
La Vache
Références cadastrales
1990 A1 705, 451, 449
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
En écart
Nom du cours d'eau traversant ou bordant l'édifice
La fontaine de la Vache
Partie constituante non étudiée
Atelier de fabrication ; logement d'ouvriers ; logement patronal ; digue ; haras ; remise ; grange ; four industriel ; serre ; logement de contremaître
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
1er quart 17e siècle ; 2e quart 17e siècle ; 2e quart 18e siècle
Commentaires concernant la datation
Daté par source
Auteur de l'édifice
Description historique
La date de création de ces forges est inconnue, toutefois, le Prieuré de la Charité possédait déjà, en 1609, un fourneau à fer, deux forges : l'une d'en haut avec 4 chambres à feu et l'autre d'en bas avec chaufferie et 5 chambres à feu au lieu dit la Vache. Ces usines sont acquises en 1723, par Berger, déjà propriétaire de Frasnay-les-Chanoines et des terres alentour. En 1744, elles sont vendues à Babaud de la Chaussade qui les utilise pour la fabrication des clous et des ancres destinées à la Marine. A cette époque le fourneau produit 450 tonnes de fonte. Les usines sont finalement achetées par le roi Louis XVI, en 1781, puis confisquées par la Nation, en 1793. Après leur aliénation, le 11 avril 1833, elles deviennent la propriété d'Alexandre de Vergennes qui arrête la forge d'en bas en 1835 pour se consacrer uniquement au haut-fourneau. Ce dernier fonctionnait toute l'année et produisait 1200 tonnes de fonte, livrée, pour une grosse partie, en gueuses brutes destinées aux usines d'Imphy. Le reste était employé pour des moulages de 1ère fusion. Le fourneau fondait du minerai provenant des minières des bois de Carcot, de Chazué et de Villate. Vers 1840, de Vergennes aidé de son maître de forge Ferrand, réutilise les gaz du gueulard pour augmenter la température du fourneau. Une roue hydraulique de 12 mètres de diamètre actionnait la soufflerie. Le débit de l'étang, qui assurait le mouvement de la roue, était renforcé par celui de la Fontaine de la Vache, dévié dans des conduites forcées en fonte. L'ensemble était complété par quatre lavoirs à bras. Ferrand arrête finalement l'exploitation industrielle le 14 juin 1848. Sa famille reste propriétaire des lieux jusqu'en 1920 après les avoir transformés en exploitation agricole. Actuellement le site a été reconverti en gîte rural, chambres d'hôtes et relais équestre.
Description
Matériaux du gros-œuvre
Calcaire ; moellon ; enduit
Matériaux de la couverture
Tuile plate ; tuile mécanique ; matériau synthétique en couverture
Description de l'élévation intérieure
2 étages carrés ; étage de comble ; étage de soubassement
Partie d'élévation extérieure
Élévation ordonnancée
Typologie de couverture
Toit à deux pans ; appentis ; croupe
Source de l'énergie utilisée par l'édifice
Énergie hydraulique
Commentaire descriptif de l'édifice
Le site, très important et très bien conservé possède encore des bâtiments que l'on trouve sur le cadastre de 1818. Le logement patronal est une belle demeure du 17ème à deux étages, flanquée de deux tours dont une a été ajoutée au 19ème. Il est placé en contrebas de la chaussée de l'étang. En face, on trouve les logements d'ouvriers et les écuries aménagées en gîte et relais équestre. Le bâtiment reconstruit au 19ème siècle est de plan rectangulaire d'un étage. Il possède une lucarne à fermette débordante. A sa droite, on trouve une petite maison qui semble avoir été le logement du contremaître. Très simple, elle est en rez-de-chaussée avec une porte d'entrée centrée en façade. Sa toiture est munie d'une lucarne. Une serre installée à la fin du XIXème siècle est située entre ces bâtiments. Le haut-fourneau a perdu son massif. Il ne reste plus que les murs percés de plusieurs oeil-de-boeuf. Des voûtes murées, à arc en plein cintre, indiquent la place des roues. L'édifice, de plan carré, est accolé à l'ancienne halle à charbon qui surprend par sa taille, plus de 45 mètres de long. Elle est surélevée par rapport au fourneau pour permettre le chargement du minerai par le haut. La charpente, en partie effondrée, est à entrait portant poinçon et chevron. Sur le terrain, on trouve encore une autre petite maison de plan rectangulaire à la fonction non définie. Vers la source de la Fontaine de la Vache, il y a la forge d'en dessus qui dépend aussi de l'ensemble industriel. Une partie de l'édifice est transformé en logement. Les bâtiments sont construits avec des murs en gros moellon de calcaire couverts par un enduit de ciment. Les toitures de tuile plate ou mécanique sont à deux pans. La demeure et le logement des ouvriers possèdent des croupes.
État de conservation (normalisé)
Établissement industriel désaffecté ; restauré
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
Propriété privée
Références documentaires
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2003
Copyright de la notice
© Inventaire général ; © Conseil général de la Nièvre
Date de rédaction de la notice
2004
Noms des rédacteurs de la notice et du dossier
Dreyer Francis
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
Dossier individuel
Adresse du dossier Inventaire
Conseil régional de Bourgogne - Service Patrimoine et Inventaire 17, bd de la Trémouille BP 23502 - 21035 Dijon cedex - 03.80.44.40.55