Ministère
de la Culture
POP | Plateforme ouverte du patrimoineéglise paroissiale Saint-Georges
église paroissiale Saint-Georges
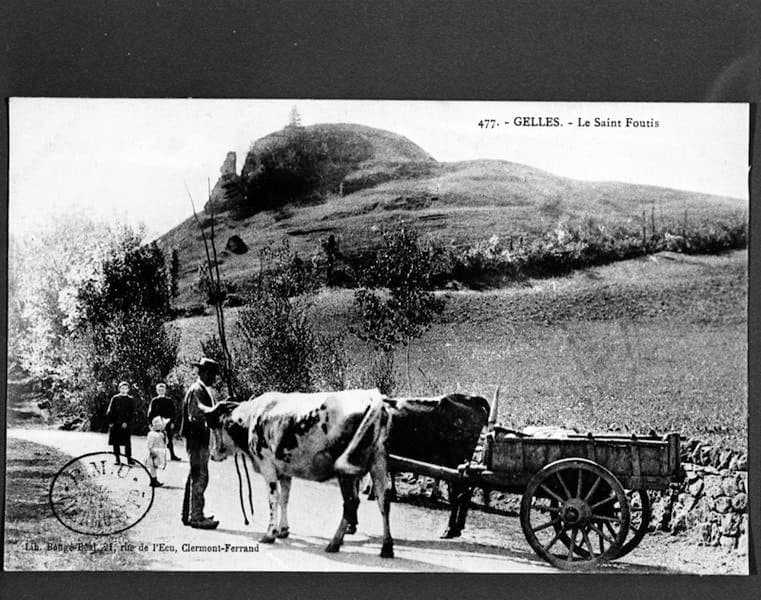
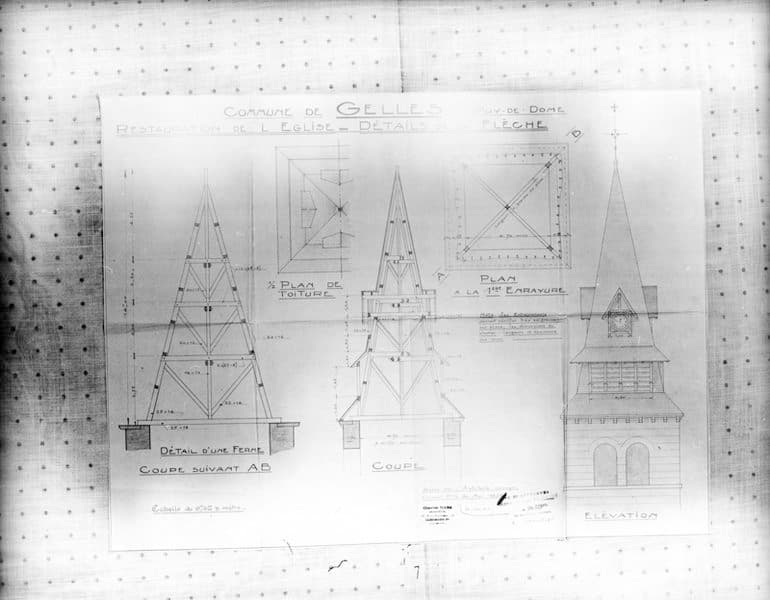
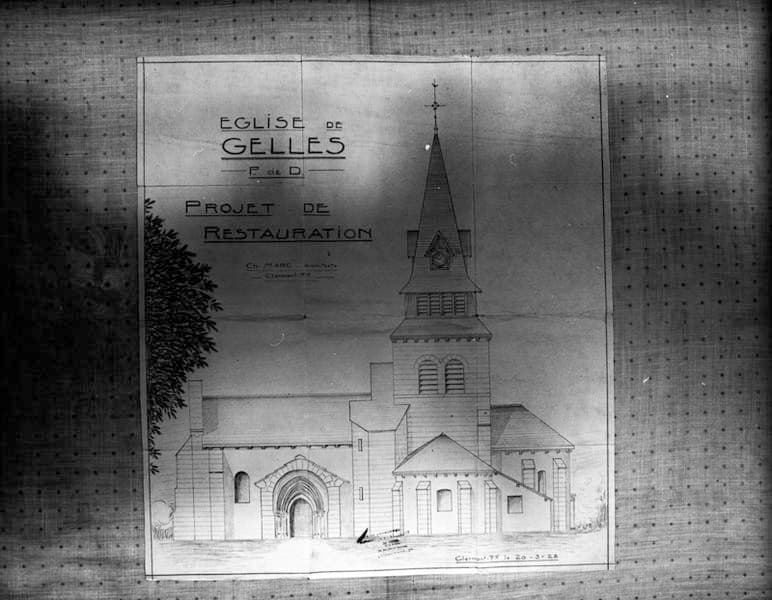

Référence de la notice
IA63000347
Nom de la base
Patrimoine architectural (Mérimée)
Producteur
Inventaire
Date de création de la notice
11 mai 2004
Date de dernière modification de la notice
21 septembre 2020
Rédacteur de la notice
Sauget Jean-Michel
Mentions légales
© Région Auvergne - Inventaire général du patrimoine culturel
Désignation de l'édifice
Titre courant
église paroissiale Saint-Georges
Producteur
Inventaire
Dénomination de l'édifice
église paroissiale
Vocable, pour les édifices cultuels
Saint-Georges
Localisation au moment de la protection ou de l'étude
Localisation
Auvergne-Rhône-Alpes ; Puy-de-Dôme (63) ; Gelles
Précision sur la localisation
Anciennement région de : Auvergne
Aire d'étude pour le domaine de l'Inventaire
Rochefort-Montagne
Références cadastrales
1823 A3 1076 ; 1984 AB 50
Milieu d'implantation pour le domaine de l'Inventaire
en village
Historique de l'édifice
Siècle de campagne principale de construction