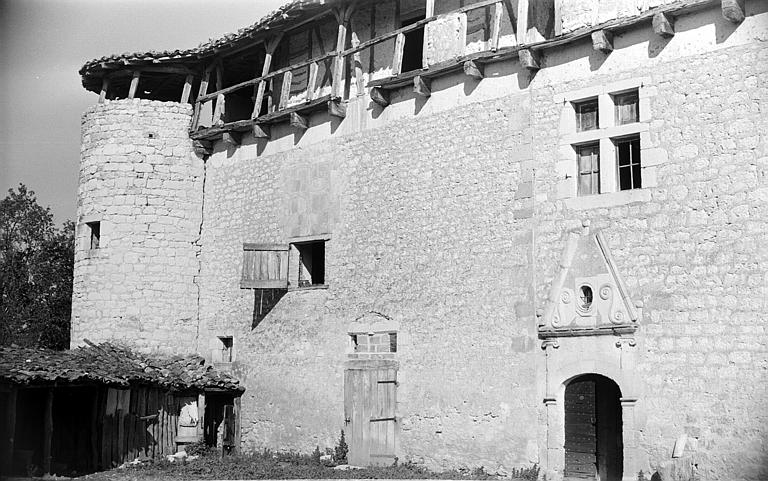Château de Mayragues
Désignation
Dénomination de l'édifice
Château
Titre courant
Château de Mayragues
Localisation
Localisation
Occitanie ; Tarn (81) ; Castelnau-de-Montmiral ; Cahuzac-sur-Vère
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Pays du Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou
Canton
Castelnau-de-Montmiral
Lieu-dit
Mayragues
Références cadastrales
1812 B 903 ; 1812 I 294 ; 2014 B 574
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
Isolé
Partie constituante non étudiée
Pigeonnier ; four à pain ; étable
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
1ère moitié 17e siècle ; 2e moitié 17e siècle
Année(s) de(s) campagne(s) de construction
1681
Commentaires concernant la datation
Date portée
Description historique
La généalogie des propriétaires du château de Mayragues nous est connue par les travaux de Michel de Tonnac à partir des archives de sa famille, " une des plus anciennes familles protestante du nord-ouest du Tarn" en possession du lieu pendant environ trois siècles. C'est Marc de Tonnac, écuyer, qui l'acquiert en 1590. Le lieu s'appelle alors Villeneuve, nom qu'il perdra par la suite au profit de Mayragues. Son successeur, Samuel, se marie en 1620 avec Antoinette de Garissoles, jeune catholique de Cordes, et " fait passer cette branche des Tonnac dans la religion catholique". Raymond, leur fils, prend le nom de sieur de Mayragues à partir du milieu du 17e siècle et crée la branche des Tonnac de Villeneuve-Mayragues. C'est à lui qu'est généralement attribuée la réalisation de la cheminée de la grande salle (Tollon, 1994 et 2012) et il faut très certainement lui octroyer aussi la construction de toute la partie est du corps de logis, la partie ouest ayant très probablement été élevée par son père dans la première moitié du siècle. Le château est resté dans la famille de Tonnac jusqu'en 1873 lorsqu'il est vendu par Henri-Hyppolyte ruiné pour avoir perdu tous ses biens au jeu. Racheté dans les années 1980 par Alan et Laurence Geddes, il est sauvé de la ruine par des travaux importants de restauration.
Description
Matériaux du gros-œuvre
Calcaire ; moellon ; pan de bois
Matériaux de la couverture
Tuile creuse
Description de l'élévation intérieure
Étage de soubassement ; rez-de-chaussée ; 2 étages carrés
Typologie du couvrement
Voûte en berceau plein-cintre
Emplacement, forme et structure de l’escalier
Escalier dans-oeuvre : escalier droit, en maçonnerie
Commentaire descriptif de l'édifice
Le château se trouve en limite des communes de Castelnau-de-Montmiral et de Cahuzac-sur-Vère. Il occupe un site d'éperon à la confluence des ruisseaux de la Mouline et de l'Istricou. Le corps de logis quadrangulaire occupe la pointe de l'éperon, à l'aplomb des ruisseaux. Selon les vestiges de murs qui subsistent à l'ouest, il semblerait que des constructions aient existé en avant du corps de logis. Le plan cadastral de 1812 montre effectivement une grande parcelle bâtie incluant le corps de logis subsistant. On peut émettre l'hypothèse d'une cour fermée par des hauts murs qui aurait pu inclure des dépendances qui venaient s'appuyer contre ce mur. Il en reste principalement une maison d'habitation située au sud-ouest du logis avec four à pain. Plus à l'ouest se trouvent encore une ancienne grange-étable, aujourd'hui convertie en chai, et le pigeonnier. Ce dernier est élevé sur des colonnes de grès, couronnées de larges chapeaux. La caisse est en pan-de-bois et le toit à quatre pans est couvert de tuiles plates et ouvert par un lanternon en bois et une lucarne, à l'est. Le corps de logis a été édifié en deux temps. Tout le tiers ouest, de construction homogène avec ses maçonneries de moellons de calcaire, a été élevé dans une première phase. Les deux chaînes d'angle visibles sur les façades sud et nord témoignent d'une première limite du bâtiment. Les salles uniques qui occupaient chacun des niveaux étaient distribuées par un escalier en vis (disparu) logé dans la tour l'angle circulaire, à l'angle sud-ouest. En façade, les pierres d'encadrement des croisées et des petites fenêtres sont pourvues d'un chanfrein retombant sur des congés droits tandis que sur l'élévation postérieure elles sont à arêtes vives. Ce premier logis a été couronné d'une galerie en pan-de-bois et en encorbellement ouverte à la manière d'un soleihlo ou comble ouvert, offrant une vue périphérique sur les environs. Une salle dont les murs sont aussi en pan-de-bois est aménagée en arrière de la galerie. L'angle nord-ouest était flanqué d'une échauguette connue par une photographie ancienne et dont il ne reste plus que les deux premières consoles en pierre. L'extension du corps de logis en direction de l'est s'inscrit dans la continuité du premier édifice. A la jonction, est élevé un escalier rampe sur rampe, distribuant ainsi les salles de part et d'autre. La galerie sommitale est poursuivie mais elle est désormais ouverte par des croisées de bois. L'angle nord-est est flanqué d'une tour pentagonale dont le premier niveau est pourvu de fente de tir, traduisant la fonction originelle de défense. Il a par la suite été transformé en chapelle. Les niveaux supérieurs de la tour faisaient fonction d'annexes aux salles du logis, ce dont témoignent les latrines dont il subsiste le conduit d'évacuation extérieur à l'articulation de la tour et du corps principal. Sous l'extension, une cave voûtée en berceau est éclairée par des petites ouvertures verticales aux encadrements pourvus d'un large chanfrein. Les maçonneries de la seconde phase de construction sont en moellons ébauchés et assisés. Les croisées tout comme les fenêtres à traverse du rez-de-chaussée sont pourvues de pierre d'encadrement à arêtes vives. La porte du logis, couverte par un arc segmentaire, est encadrée par des piédroits couronnés de chapiteaux ioniques et surmontée d'un fronton ouvert par un oeil de boeuf et encadré par deux volutes en S. A l'intérieur, les salles sont équipées de grandes cheminées et les plafonds à solives sont ornés de décors peints. Au rez-de-chaussée, la cheminée de la salle ouest est une reconstruction récente à partir de blocs sculptés en remploi. La cheminée de la salle orientale est engagée dans le mur et seule la tablette moulurée et supportée par une frise de denticule est débordante. Un cadre en stuc marque l'emplacement de la hotte droite. Les planches entre les solives du plafond sont recouvertes d'un décor floral et les poutres de rinceaux habités et de portrait en médaillon portés par des anges. A l'étage, la cheminée ouest à hotte droite reçoit un décor peint représentant la Sainte-Famille : La Vierge, assise à gauche, reconnaissable par son manteau bleu, tient l'Enfant Jésus sur ses genoux. Au centre, Elisabeth agenouillée présente l'enfant Jean-Baptiste tandis que derrière elle se tient Zacharie. A droite enfin, en pendant à la Vierge, se trouve saint Joseph assis. Au bas de la scène, à gauche, on peut distinguer l'inscription "de Graves.fecit". La date de 1656 y était associée selon la propriétaire. Le plafond, quant à lui, présente un décor peint de motifs végétaux et géométriques de couleur jaune, bleu, noir et blanc. Deux portraits sont peints sur la poutre du mur sud. Les deux salles qui occupent actuellement la partie orientale du premier étage constituaient à l'origine la grande salle du logis, pourvue d'une cheminée monumentale en stuc richement ornée. Le plafond est peint de rinceaux habités et de cornes d'abondance ou de corbeilles chargés de fruits. Sur une des poutres, la date de 1681 est inscrite. Les couleurs principales qui subsistent sont les mêmes que celles de la salle voisine. La datation de ce décor peint constitue le terminus ante quem de la seconde campagne de construction.
Protection et label
Date et niveau de protection de l'édifice
1961/10/10 : inscrit MH
Précision sur la protection de l'édifice
Château de Meyragues et son pigeonnier (cad. B 574) : inscription par arrêté du 10 octobre 1961, avec erreur sur le toponyme, Mayragues est le nom usuel.
Nature de l'acte de protection
Arrêté
Précisions sur les éléments protégés
Pigeonnier
Référence aux objets conservés
IM81013022
Intérêt de l'édifice
À signaler
Eléments remarquables dans l'édifice
Cheminée
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
Propriété d'une personne privée
Références documentaires
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2012
Copyright de la notice
(c) Conseil départemental du Tarn ; (c) Inventaire général Région Occitanie
Date de rédaction de la notice
2014
Noms des rédacteurs de la notice et du dossier
Servant Sonia
Typologie du dossier
Dossier individuel
Adresse du dossier Inventaire
Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47