Ministère
de la Culture
POP | Plateforme ouverte du patrimoinecouvent de carmélites déchaussées
couvent de carmélites déchaussées



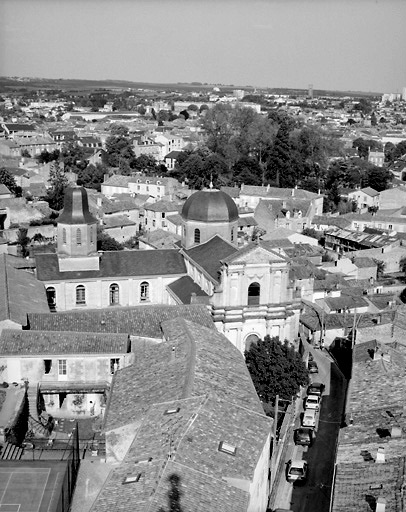


Référence de la notice
IA85000503
Nom de la base
Patrimoine architectural (Mérimée)
Producteur
Inventaire
Date de création de la notice
26 décembre 2002
Date de dernière modification de la notice
3 décembre 2004
Rédacteur de la notice
Réau Marie-Thérèse
Mentions légales
© Inventaire général
Désignation de l'édifice
Titre courant
couvent de carmélites déchaussées
Producteur
Inventaire
Dénomination de l'édifice
couvent
Qualité des personnes pour qui l'édifice a été construit ou transformé
de carmélites déchaussées
Vocable, pour les édifices cultuels
Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; le Sacré-Coeur-de-Jésus
Localisation au moment de la protection ou de l'étude
Localisation
Pays de la Loire ; Vendée (85) ; Fontenay-le-Comte ; rue Nicolas-Rapin
Aire d'étude pour le domaine de l'Inventaire
Fontenay-le-Comte commune
Adresse de l'édifice
Nicolas-Rapin (rue)
Références cadastrales
1984 BH 475
Milieu d'implantation pour le domaine de l'Inventaire
en ville
Partie constituante non étudiée
chapelle
Historique de l'édifice
Siècle de campagne principale de construction
Commentaire concernant la datation
daté par source
Auteur de l'édifice
Commentaire concernant l'attribution de l'édifice
attribution par source
Description historique
Le carmel de la rue Nicolas-Rapin a été fondé par les carmélites déchaussées du couvent d'Ypres, en Belgique, réfugiées à Fontenay pendant la première guerre mondiale ; il s'agit donc d'un transfert plus que d'une véritable fondation. L'autorisation apostolique a été octroyée le 22 février 1922 et le couvent a été placé sous le vocable de Notre-Dame-du-Carmel et du Sacré-Coeur-de-Jésus. L'histoire du carmel de Fontenay est relatée dans les Annales du carmel de Vlaterminge, d'après le témoignage direct de religieuses y ayant vécu. Les religieuses sont arrivées à Fontenay fin 1919 et ont acquis les propriétés de Virçay et de Laroque-Latour, rue Rapin. La construction s'est faite essentiellement sur des terrains non bâtis. Dans la partie ouest, des demeures ont été remaniées et intégrées au monastère. La construction a novo de la chapelle, très soignée, ainsi que celle des ailes nord et est des bâtiments conventuels, a débuté en 1930 seulement et n'a jamais été véritablement achevée ; il n'y a aucune trace de bâtiment neuf sur les vues aériennes prises en 1926 et, en 1930, il est question de fondations par l'entreprise fontenaisienne Léon Henri, ce qui confirme le témoignage des Annales. Les travaux ont été financés par la première prieure, mère Marguerite-Marie, membre d'une très riche famille de Bruges dont le chef avait légué tous ses biens au carmel. On ignore le nom de l'architecte, mais selon le voeu de la seconde prieure, mère Marie-Madeleine, l'oeuvre s'inspire directement du carmel de Lisieux pour les bâtiments conventuels et pour la chapelle ; la façade de cette dernière, en particulier, est une réplique de celle de Lisieux, reconstruite vers 1920 par les architectes Adline, de Lisieux, et R. Ménage, de Caen. L'éventuelle participation de l'un de ces deux architectes, non prouvée jusqu'à présent, demeure une hypothèse non négligeable. Les religieuses, qui n'étaient plus que cinq, ont définitivement quitté le couvent en 1958 ; la prieure rejoignit le carmel de Fatima et emmena avec elle le mobilier religieux. Dès 1958, les bâtiments ont été rachetés par l'institution Saint-Joseph et intégrés à l'école ; en 1995, ils ont été acquis par un particulier.
Description de l'édifice
Matériaux du gros-œuvre
calcaire ; pierre de taille ; moellon ; enduit
Matériaux de la couverture
ardoise
Typologie de plan
plan allongé
Description de l'élévation intérieure
3 vaisseaux ; 1 étage carré
Typologie du couvrement
voûte en berceau ; voûte d'arêtes ; coupole
Partie d'élévation extérieure
élévation à travées ; élévation ordonnancée sans travées
Typologie de la couverture
toit à longs pans ; appentis ; terrasse ; dôme polygonal ; toit à l'impériale
Commentaire descriptif de l'édifice
L'église est construite en pierre de taille avec des toitures en ardoise, toit à longs pans pour la nef centrale voûtée en berceau, appentis pour les bas-côtés voûtés d'arêtes, dôme octogonal pour le choeur coiffé d'une coupole. Les bâtiments conventuels sont construits en moellons enduits et couverts de toits à longs pans, en ardoise pour l'aile est surmontée d'un clocher à toit à l'impériale, en fibrociment pour l'aile nord, en tuile creuse pour l'aile ouest, maison ancienne remaniée et intégrée au couvent. Par ailleurs, des portiques couverts de terrasses longent l'église et l'aile est.
Technique du décor porté de l'édifice
sculpture
Indexation iconographique
ordre ionique, ordre corinthien, fronton, ordre religieux : symbole
Description de l'iconographie
La façade de la chapelle est rythmée de colonnes ioniques et corinthiennes superposées, l'intérieur de colonnes et de pilastres ioniques. Le fronton de la façade est orné d'un écu avec les armes du Carmel.
Date de l'enquête ou du récolement
1995
Statut juridique, intérêt, protection et label
Typologie de la zone de protection
secteur sauvegardé
Élément remarquable dans l'édifice
chapelle
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
propriété privée
Références documentaires
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
dossier individuel
Date de rédaction de la notice
2001
Mentions légales
© Inventaire général
Voir aussi
Lien vers le dossier PDF

Référence de la notice
IA85000503
Nom de la base
Patrimoine architectural (Mérimée)
Producteur
Inventaire
Date de création de la notice
26 décembre 2002
Date de dernière modification de la notice
3 décembre 2004
Rédacteur de la notice
Réau Marie-Thérèse
Mentions légales
© Inventaire général
Contactez-nousEnvoyer un courriel