Usine de porcelaine de la S.A. Porcelaines Lafarge et Compagnie, puis Porcelaine Ph. Deshoulières
Désignation
Dénomination de l'édifice
Usine de porcelaine
Appellation d'usage
S.A. Porcelaines Lafarge et Compagnie, puis Porcelaine Ph. Deshoulières
Titre courant
Usine de porcelaine de la S.A. Porcelaines Lafarge et Compagnie, puis Porcelaine Ph. Deshoulières
Localisation
Localisation
Nouvelle-Aquitaine ; Haute-Vienne (87) ; Limoges ; 20 rue Arthur-Groussier
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Limoges
Canton
Limoges-Le Vigenal
Lieu-dit
La Bastide
Adresse de l'édifice
Arthur-Groussier (rue) 20
Références cadastrales
2002 SN 13
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
En ville
Partie constituante non étudiée
Atelier de fabrication ; bureau d'entreprise ; entrepôt industriel
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
3e quart 20e siècle
Année(s) de(s) campagne(s) de construction
1962
Commentaires concernant la datation
Daté par source
Auteur de l'édifice
Commentaires concernant l'attribution de l'édifice
Attribution par source
Description historique
En 1962 Henri Lafarge fait construire par l'architecte limougeaud R. Lescure cette usine de porcelaine, comprenant des ateliers de fabrication et de décoration. Implantés depuis 1928 dans l'ancienne usine de porcelaine Paroutaud située au n° 217 rue François Perrin, H. Lafarge et Demarty rachètent dès 1930 les parts de leurs associés de l'Union Porcelainière. En 1941 Lafarge et Nardon créent la Société Limoges Porcelaine qui fusionne avec l'Union Porcelainière à la mort de Nardon. Finalement, en 1963, l'Union Porcelainière est dissoute, lors de son installation dans la nouvelle usine de porcelaine de la Bastide, et remplacée par la S.A. Porcelaine Lafarge et Cie. Devenue la propriété du groupe AXA Assurance puis du décorateur parisien Laure Japy en 1994, l'usine dépose son bilan en 1997. Elle est alors rachetée par la société Porcelaine Ph. Deshoulières (installée depuis 1984 à Limoges dans l'ancienne usine Feuillade, rue Armand-Dutreix). Depuis cette date, la fabrication proprement dite est abandonnée, l'usine se tournant exclusivement vers la décoration. La porcelaine blanche provient de l'usine du Dorat (87). En 1962 H. Lafarge projette l'installation de deux fours au gaz de Lacq du Constructeur Coudamy d'une capacité de 7 m3 chacun, pour la cuisson de la porcelaine, ainsi que de moufles électriques pour la décoration. En 1976 est installé un four-tunnel à haute température pour la cuisson rapide des décors, technique mise au point pour abaisser la quantité de plomb nécessaire. En 1997-1998, la société Ph. Deshoulières installe le four-tunnel au gaz Coudamy qu'elle employait alors rue Armand-Dutreix. L'usine dispose aussi de deux petits fours électriques pour la cuisson de pièces particulières (grosses pièces...). En 1977 l'usine employait une centaine de personnes, 126 en 1988, 50 en 2002.
Description
Matériaux du gros-œuvre
Acier
Matériaux de la couverture
Béton en couverture ; ciment amiante en couverture
Description de l'élévation intérieure
Étage de soubassement ; 2 étages carrés
Typologie de couverture
Toit à longs pans ; terrasse ; croupe
Source de l'énergie utilisée par l'édifice
Énergie électrique ; énergie thermique ; achetée
Commentaire descriptif de l'édifice
L'usine est composée d'un vaste atelier formant un U, auquel sont accolés un bâtiment à usage de bureaux et un entrepôt industriel. Tous sont constitués d'une structure en acier (poteaux, poutres et charpentes). La partie centrale et l'aile sud sont en rez-de-chaussée, l'aile nord dispose de deux niveaux, les bureaux de trois niveaux. L'ensemble est couvert de toits à longs pans avec croupes, en ciment-amiante, à l'exception des bureaux, couverts d'un toit-terrasse. Les murs extérieurs sont percés de baies formant un bandeau continu (huisserie en aluminium) , soulignés au niveau des allèges d'un bandeau continu de petits carreaux en céramique bleue.
Protection et label
Référence aux objets conservés
IM87001663 ; IM87001664 ; IM87001665
Eléments remarquables dans l'édifice
Machine de production (étudiée dans la base Palissy)
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
Propriété privée
Références documentaires
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2002
Copyright de la notice
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Limoges
Date de rédaction de la notice
2002
Noms des rédacteurs de la notice et du dossier
Pillet Frédéric
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
Dossier individuel
Adresse du dossier Inventaire
Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de la Région - Service du Patrimoine et de l’Inventaire, site de Limoges - 27, boulevard de la Corderie - CS 3116 - 87031 Limoges Cedex 1 - 05 55 45 19 00













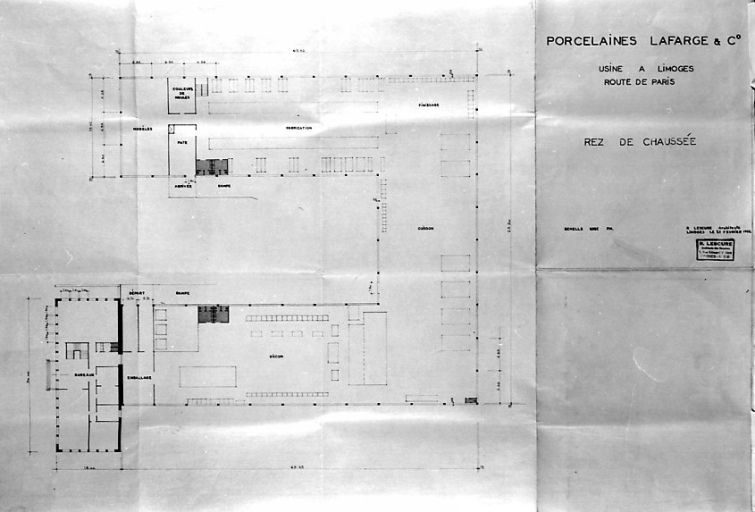
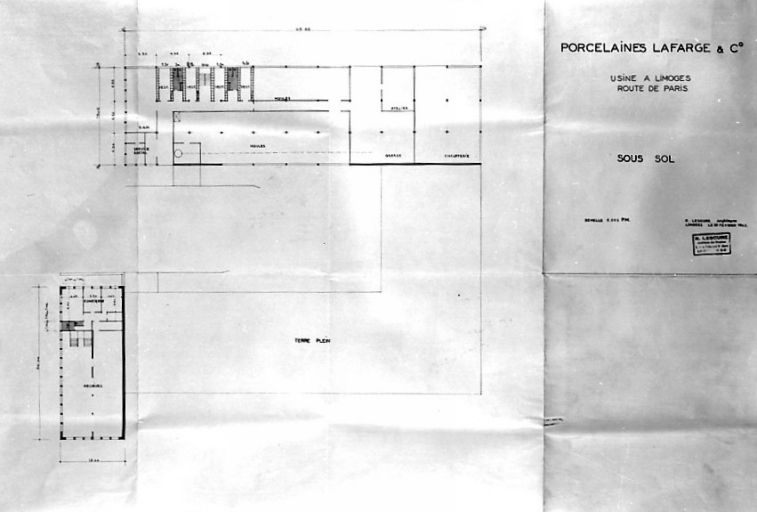
!['Usine Lafarge - N 20 [vers 1963]'. Vue aérienne de l'usine encore en travaux.](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR74_20028700543NUC/ivr74_20028700543nuc_p.jpg)
!['Palais des expositions en construction [vers 1963]'. Vue aérienne : en arrière-plan, l'usine Lafarge en travaux.](https://pop-perf-assets.s3.gra.io.cloud.ovh.net/memoire/IVR74_20028700544NUC/ivr74_20028700544nuc_p.jpg)


