Ministère
de la Culture
POP | Plateforme ouverte du patrimoineFonderie typographique Jules Dutreix et Compagnie, puis Fonderie Centrale Typographique, puis France Fonderies Typographiques
Fonderie typographique Jules Dutreix et Compagnie, puis Fonderie Centrale Typographique, puis France Fonderies Typographiques




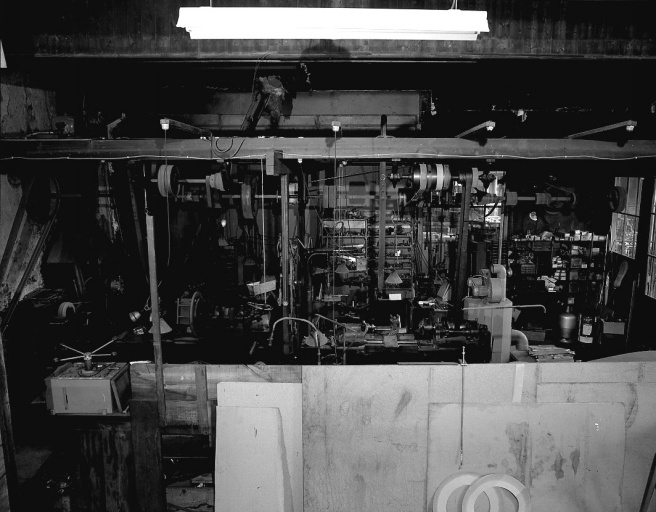

Référence de la notice
IA87000223
Nom de la base
Patrimoine architectural (Mérimée)
Producteur
Inventaire
Date de création de la notice
22 janvier 2004
Date de dernière modification de la notice
8 novembre 2022
Rédacteur de la notice
Pillet Frédéric
Mentions légales
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Limoges
Désignation de l'édifice
Titre courant
Fonderie typographique Jules Dutreix et Compagnie, puis Fonderie Centrale Typographique, puis France Fonderies Typographiques
Appellation d'usage
Fonderie Jules Dutreix et Compagnie ; Fonderie Centrale Typographique ; France Fonderies Typographiques
Producteur
Inventaire
Dénomination de l'édifice
fonderie
Précision sur la typologie de l'édifice
fonderie typographique
Localisation au moment de la protection ou de l'étude
Localisation
Nouvelle-Aquitaine ; Haute-Vienne (87) ; Limoges ; 94 rue François-Perrin
Aire d'étude pour le domaine de l'Inventaire
Limoges
Canton
Limoges-Emailleurs
Adresse de l'édifice
François-Perrin (rue) 94
Références cadastrales
2002 IM 209
Milieu d'implantation pour le domaine de l'Inventaire
en ville
Partie constituante non étudiée
atelier de fabrication ; logement
Historique de l'édifice
Siècle de campagne principale de construction
Année(s) de(s) campagne(s) de construction
1924 ; 1933
Commentaire concernant la datation
daté par travaux historiques ; daté par tradition orale
Auteur de l'édifice
Description historique
Vers 1883, Jules Dutreix, qui exploite déjà une fonderie typographique à Limoges en association avec M. Malinvaud depuis 1876, implante sur ce site de nouveaux ateliers. La société Jules Dutreix et Compagnie, spécialisée dans la fabrication de caractères d'imprimerie est dirigée de 1914 à 1972 environ par Pierre Dutreix. En 1924 et 1933, les ateliers de fabrication sont agrandis, tandis qu'un atelier de mécanique est construit pour l'entretien des machines de l'usine. Il est par la suite transféré dans le bâtiment de 1883. L'entreprise, après avoir porté le nom de Fonderie Centrale Typographique puis Fonderies Centrales Dutreix, est reprise en 1972 par la société France Fonderies Typographiques. Elle subit un dépôt de bilan en 1983. Aujourd'hui associée à la fonderie typographique suisse Haas, l'entreprise est l'une des toutes dernières en activité en France. Depuis 1974 la production s'est axée uniquement sur le caractère de type Anglais, à forte valeur ajoutée. Vers 2000 un premier ensemble de 16 machines à fondre a été ferraillé. L'usine doit fermer vers 2005, avec le départ en retraite du dernier ouvrier.£Les ateliers sont équipés d'un ensemble de machines (étudiées) pour l'essentiel datées de la première moitié du 20e siècle, mues électriquement par des moteurs individuels ou collectifs, avec systèmes de distribution par courroies. Spécialisées dans la fabrication de caractères anglais, ces machines proviennent pour la plupart de la fonderie typographique parisienne Deberny et Peignot, fermé en 1974.£L'usine emploie 30 ouvriers en 1885, 35 en 1895, 32 en 1926, 25 en 1950, 15 en 1965, 3 en 2003.
Description de l'édifice
Matériaux du gros-œuvre
pierre ; calcaire ; moellon ; enduit
Matériaux de la couverture
tuile mécanique
Description de l'élévation intérieure
1 étage carré
Partie d'élévation extérieure
élévation à travées
Typologie de la couverture
toit à longs pans
Commentaire descriptif de l'édifice
Les ateliers et le logement construits vers 1883 forment un seul corps de bâtiment. Il est en moellon de pierre enduit partiellement, couvert d'un toit à longs pans en tuile mécanique. Les ateliers, en rez-de-chaussée, sont subdivisés en trois parties : au centre l'ancien bureau reconverti en atelier de mécanique, et de part et d'autre les ateliers de fonderie de caractères, dont un est désaffecté. La façade antérieure des ateliers est percée de neuf grandes baies, dont la baie centrale est traitée en porte-fenêtre. Chacune de ces baies est encadrée de piédroits en pierres de taille en calcaire harpées et couverte d'une plate-bande en bâtière. Jusqu'au niveau des appuis, la façade antérieure est constituée d'un appareil simple, régulier et allongé en calcaire. Les fermes en bois de la charpente, initialement apparente, repose sur des corbeaux en pierre de taille. L'extrémité sud du corps de bâtiment est occupée par les bureaux actuels, qui se sont substitués probablement à un logement. Ils sont composés d'un rez-de-chaussée et d'un étage carré. Le pignon sud est percé de baies en arc segmentaire (ainsi que deux travées en retour) et d'un oculus. Les ateliers des années 1924-1933, construits dans le prolongement de ceux de 1883, forment un L. Ils sont similaires à ceux de 1883, à l'exception des baies, traitées de façon hétérogène. A l'entrée du site, en alignement sur la rue François-Perrin, s'élève l'ancien atelier de mécanique, en rez-de-chaussée.
Date de l'enquête ou du récolement
2003
Statut juridique, intérêt, protection et label
Intérêt de l'édifice
à signaler
Élément remarquable dans l'édifice
machine de production (étudiée dans la base Palissy) ; atelier de fabrication
Observation concernant la protection de l'édifice
Les ateliers de fabrication de 1883 sont remarquables par leur état de conservation, par le peu de transformations internes et externes subies depuis les premières décennies du 20e siècle, et par l'ensemble des machines de production conservées et toujours en état de marche.
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
propriété privée
Références documentaires
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
dossier avec sous-dossier
Date de rédaction de la notice
2003
Mentions légales
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Limoges
Sources complémentaires
Adresse de conservation et consultation du dossier
Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de la Région - Service du Patrimoine et de l’Inventaire, site de Limoges - 27, boulevard de la Corderie - CS 3116 - 87031 Limoges Cedex 1 - 05 55 45 19 00
Voir aussi
Lien vers le dossier PDF
Lien vers le PDF de l'étude (dossier vert pour l'Inventaire)

Référence de la notice
IA87000223
Nom de la base
Patrimoine architectural (Mérimée)
Producteur
Inventaire
Date de création de la notice
22 janvier 2004
Date de dernière modification de la notice
8 novembre 2022
Rédacteur de la notice
Pillet Frédéric
Mentions légales
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Limoges
Contactez-nousEnvoyer un courriel