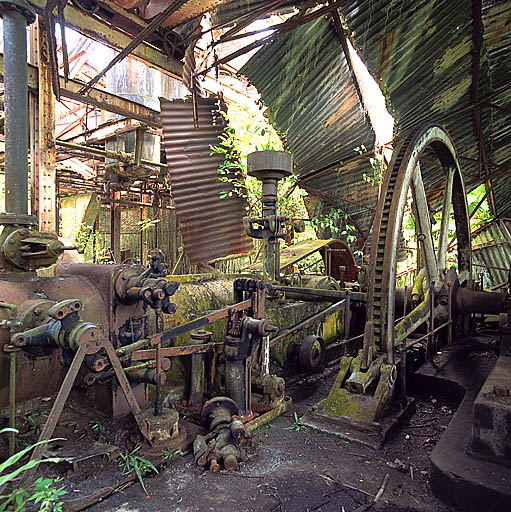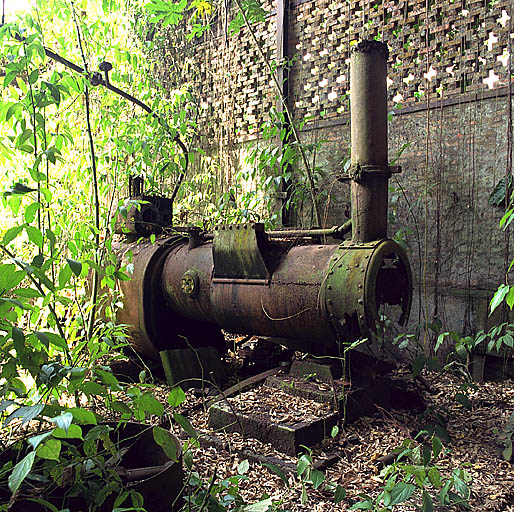Sucrerie et distillerie dite Usine de Lamirande
Désignation
Dénomination de l'édifice
Sucrerie ; distillerie
Appellation d'usage
Usine de Lamirande
Titre courant
Sucrerie et distillerie dite Usine de Lamirande
Localisation
Localisation
Guyane ; Guyane (973) ; Matoury ; R.N. 2 PK 7
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Matoury
Lieu-dit
Lamirande
Adresse de l'édifice
R.N. 2 PK 7
Références cadastrales
1991 AE
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
En écart
Partie constituante non étudiée
Atelier de fabrication ; logement d'ouvriers ; atelier de réparation ; chaufferie
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
2e quart 20e siècle
Année(s) de(s) campagne(s) de construction
1927
Commentaires concernant la datation
Datation par travaux historiques
Auteur de l'édifice
Personnalités liées à l'histoire de l'édifice
Gober Eugène, Jean-Charles Chanel, Eugène Lautier (commanditaire)
Description historique
En 1924, Léon Perrier, ministre des colonies, attribua à la Guyane un contingentement de rhum de 150 hectolitres. Entrevoyant les possibilités d'enrichissement par le biais de cette production, Eugène Gober (maire de Cayenne) , Jean-Charles Chanel (gouverneur de la Guyane nommé en 1924) et Eugène Lautier (député de la Guyane élu en 1924) décidèrent de s'associer pour créer une usine centrale comme aux Antilles. En 1925, ils acquièrent des terrains sur le site de Lamirande, par le biais de la Société Cotonnière de Gober, terrains vides de toutes plantations en canne. En 1926, ils firent pression sur le gouvernement pour obtenir un contingentement plus grand : ils obtinrent 700 hectolitres. En 1927, date de construction de l'usine, ils fondèrent la Société des Comptoirs Généraux Guyanais (nouvelle dénomination de la Maison Nazaire et Michel, société d'import-export de Gober) , filiale de la Société Sucrière et Agricole de la Guyane, chargée de l'importation des matériaux et du matériel pour l'usine. Dans un second temps, ils fusionnèrent la Société Sucrière avec la Société Cotonnière. En 1928, ils cotèrent l'usine en bourse au moment même où elle entrait en production. Peu à peu, elle s'imposa comme une usine centrale, en attirant à elle toutes les productions des petits planteurs et en mobilisant pour elle seule 150 hectares de terres cultivées. Le 4 janvier 1929, elle créa sa rhumerie ; en 1935, elle cessa sa production de sucre. Face à la chute du cours du sucre et du rhum en 1934, et à un déficit de main-d'oeuvre, elle prît un crédit à la Banque de Guyane et fit appel aux travailleurs antillais. Mais, en 1940, les 2 dirigeants du Conseil d'administration, André Khan et René Seban, d'origine juive, furent poursuivis par le gouvernement de Vichy ; André Khan prit le maquis et René Seban fut arrêté. Parallèlement, la banque demanda le remboursement immédiat de son prêt. En 1942, la Banque se porta adjudicataire de l'usine, elle en devint propriétaire et la donna à bail pour 6 ans à l'ancien contremaître de l'usine, G. Voluminie. Par la suite, elle fût rachetée par son concurrent direct, Georges Prévot, qui la fît fonctionner jusqu'en 1970.
Description
Matériaux du gros-œuvre
Métal ; brique ; pan de métal
Matériaux de la couverture
Tôle ondulée
Description de l'élévation intérieure
Sous-sol
Typologie de couverture
Toit à longs pans ; croupe ; lanterneau
Emplacement, forme et structure de l’escalier
Escalier de distribution : escalier symétrique, en charpente métallique ; escalier intérieur : escalier en équerre, en charpente métallique
Source de l'énergie utilisée par l'édifice
Produite sur place ; machine à vapeur à piston ; énergie thermique
Commentaire descriptif de l'édifice
Le bâtiment est constitué d'une charpente métallique de 10 piliers réparties le long des murs gouttereaux, avec des murs en brique, et en briques ajourées dans la partie haute des murs. Il est ouvert du côté du moulin. Un escalier symétrique métallique permet d'accéder à une passerelle permettant de couvrir toute l'usine. Il se situe à droite de l'aire de stockage des cuves, en face d'une porte d'entrée. L'usine se divise en plusieurs aires : de broyage de la canne, de filtrage du vesou et de stockage. Elle possède également un atelier de réparation dans ses murs. L'accès aux cendriers de la chaudière se fait par un sous-sol.
État de conservation (normalisé)
Établissement industriel désaffecté ; envahi par la végétation ; mauvais état
Protection et label
Intérêt de l'édifice
À signaler
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
Propriété privée
Références documentaires
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2001
Copyright de la notice
© Inventaire général
Date de rédaction de la notice
2001
Noms des rédacteurs de la notice et du dossier
Cazelles Nathalie
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
Dossier individuel
Adresse du dossier Inventaire
Conseil régional de Guyane - Service chargé de l'Inventaire 95, avenue du Général de Gaulle - BP 11 97321 Cayenne - 05.94.25.54.00