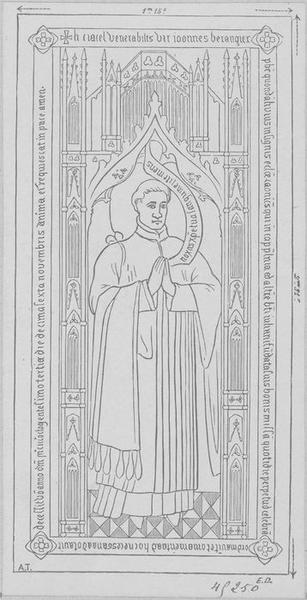Dalle funéraire à effigie gravée de Jean Bérangier, chanoine de Saint-Quentin
Désignation
Dénomination de l'objet
Dalle funéraire
Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique
Dalle à effigie gravée
Appellation d'usage
De Jean Bérangier, chanoine de Saint-Quentin
Titre courant
Dalle funéraire à effigie gravée de Jean Bérangier, chanoine de Saint-Quentin
Localisation
Localisation
Hauts-de-France ; Aisne (02) ; Saint-Quentin ; Ancienne collégiale royale, actuellement basilique Saint-Quentin
Numéro INSEE de la commune
02691
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Saint-Quentinois
Canton
Saint-Quentin
Adresse de l'édifice
Ancienne collégiale royale, actuellement basilique Saint-Quentin
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
En ville
Emplacement de l’œuvre dans l’édifice
Devant l'autel de la deuxième chapelle sud de la nef ou chapelle Sainte-Madeleine
Description
Catégorie technique
Taille de pierre ; sculpture
Structure et typologie
Plan (rectangulaire vertical) ; encastré ; au sol
Matériaux et techniques d'interventions
Calcaire (noir, monolithe) : taillé, poli, gravé, décor dans la masse, décor à relief gravé
Description matérielle
La dalle funéraire est en pierre calcaire dite de Tournai, un calcaire carbonifère de coloration noire, aussi appellé pierre bleue en raison de l'aspect gris-bleuté que lui donne le polissage. Elle est encastrée au centre du pavement de la chapelle, la tête du défunt à l'est. De plan rectangulaire, elle comporte un décor à relief gravé. L'épitaphe, gravée entre deux filets, se poursuit sur les quatre côtés, interrompue aux angles par un médaillon quadrilobé en creux. Ces quadrilobes étaient à l'origine rapportés dans un matériau d'une autre couleur, marbre, calcaire blanc ou cuivre. Certains creux visibles sur le champ de la dalle étaient peut-être à l'origine occupés, soit par des lames de pierre ou de métal, soit par une impastation.
Indexation iconographique normalisée
Figure ; homme ; chanoine ; en pied ; de trois-quarts ; prière ; phylactère ; coussin ; ornement ; arc polylobé ; quadrilobe
Description de l'iconographie
Jean Bérangier est représenté debout, de trois-quarts, dans son habit de chanoine, les mains jointes en prière, la tête sur un coussin. Il porte, repliée sur son avant-bras droit, son aumusse (capuchon et courte pélerine de fourrure) bordée de queues en fourrure. Il se tient sous un arc polylobé reposant sur deux pilastres ornés. Un phylactère est déroulé devant son visage. Le creux en forme de quadrilobe, visible à chaque angle de la dalle, accueillait probablement à l'origine une représentation des quatre symboles évangéliques, comme on le voit sur d'autres dalles contemporaines.
Dimensions normalisées
H = 233,5 ; la = 117,5.
État de conservation (normalisé)
Mauvais état ; manque
Précisions sur l'état de conservation
La surface de la dalle est usée et effacée. La partie superficielle de l'épiderme de la pierre souffre d'une exfoliation entraînant la perte de nombreuses écailles du matériau. Des cassures sont visibles sur les quatre bords. Il manque toutes les parties rapportées.
Inscription
Épitaphe (gravé, sur l'oeuvre, partiellement illisible, latin, connu par document) ; inscription (gravé, sur l'oeuvre, partiellement illisible, connu par document, latin)
Précisions sur l'inscription
L'épitaphe est gravée sur le pourtour de la dalle. L'usure de la surface rend les inscriptions presque entièrement illisibles sur trois des quatre côtés. Il est néanmoins possible de compléter l'épitaphe grâce à des relevés anciens. Epitaphe : Hic iacet [vener]abil[is vir ioannes berangier pbr/quondam huius insignis ecclesiae canonicus qui in cappellania ad altare bti] iuliani fundata suis bonis missa quotidie perpetuo [celebrè / ordinavit et ornamenta ad hoc necessaria adotavit] / Decessit vo anno dni m° cccc° octuagesimo tercio die decima sexta me[n]sis nove[m]bris anima ei requiescat in pace Amen. Traduction approximative : Ici repose vénérable homme messire Jean Bérangier, prêtre, jadis chanoine de cette insigne église, qui, dans la chapellenie fondée à l'autel du bienheureux Julien, a mis en place une messe quotidienne à célébrer à perpétuité, pour son bien. Pour cela, il l'a dotée des ornements nécessaires. Il mourut l'an du seigneur 1483, le 16e jour du mois de novembre. Que son âme repose en paix. Ainsi soit-il. Le phylactère devant la tête du chanoine renferme également une inscription latine de six mots, très usée. On y reconnaît juste les mots et lettres : noxas [...] tuo sa[...]e [..]le meas. Charles Gomart, dans un article de 1870 restitue ainsi cette phrase : Noxas Christe tuo sanguine dele meas. Il s'agit donc du voeu, exprimé par le chanoine, que le sang du Christ efface ses fautes.
Historique
Siècle de création
4e quart 15e siècle
Description historique
Cette dalle funéraire est celle du chanoine Jean Bérangier, décédé le 16 novembre 1483. L'épitaphe précise qu'il avait fondé une messe quotidienne à perpétuité, à célébrer à l'autel de Saint-Julien, pour le repos de son âme. Il avait également doté la chapelle Saint-Julien de tous les ornements nécessaires. Sous l'Ancien Régime, l'autel de la chapelle Saint-Julien se trouvait dans le bras sud du grand transept, adossé contre le pilier séparant le collatéral sud du choeur en deux vaisseaux parallèles. Le chanoine de La Fons rapporte que Jean Bérangier fut enterré devant l'autel Saint-Julien et que cette dalle a recouvert sa tombe. La chapelle Saint-Julien est supprimée au moment de la Révolution, et le dallage de l'église est restauré et remanié dès cette période, puis dans la première moitié du 19e siècle. En 1855, le baron de Guilhermy signale cette dalle, dans le bas-côté sud de la nef. Elle change de place dans les années qui suivent, puisqu'en 1871, l'architecte Malézieux la dessine, précisant qu'elle se trouve alors debout, dans le grand transept, contre le pignon sud. Enfin, elle gagne la chapelle Sainte-Madeleine, avant la fin du 19e siècle. Les guides de visite du début du 20e siècle la mentionnent alors à la place qu'elle occupe toujours aujourd'hui.
Statut juridique et protection
Statut juridique du propriétaire
Propriété de la commune
Date et typologie de la protection
classé au titre immeuble
Intérêt de l'objet
À signaler
Références documentaires
Cadre de l'étude
Dénomination du dossier
Sous-dossier
Intitulé de l'ensemble
Ensemble des monuments funéraires et commémoratifs de la basilique
Référence de l'ensemble
IM02004644
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2001
Date de rédaction de la notice
2008