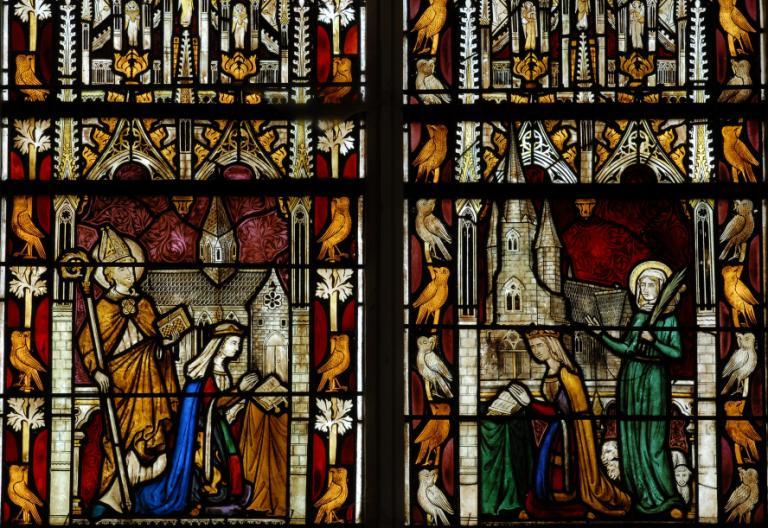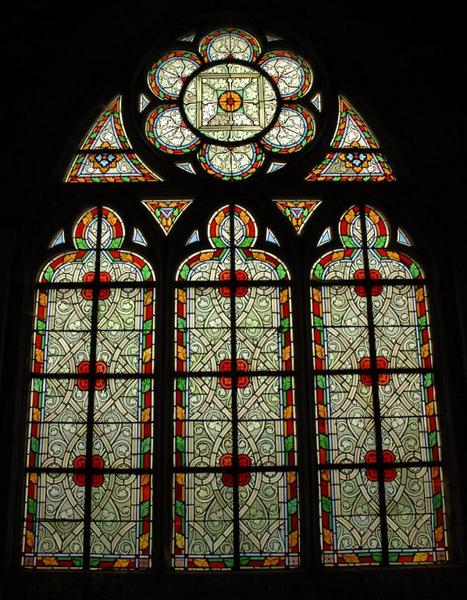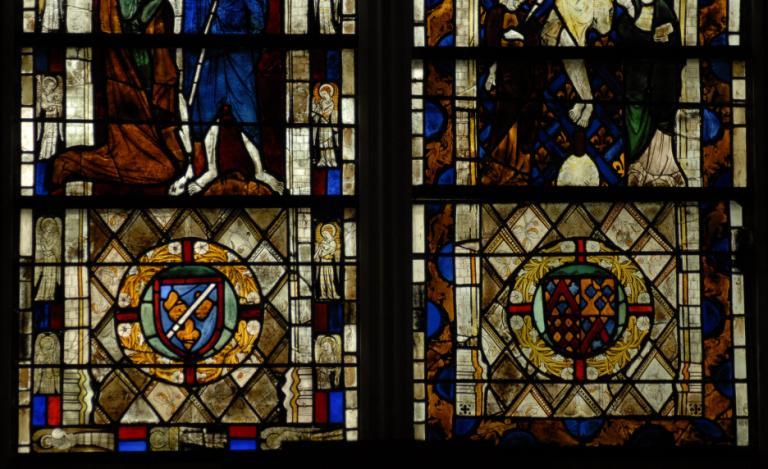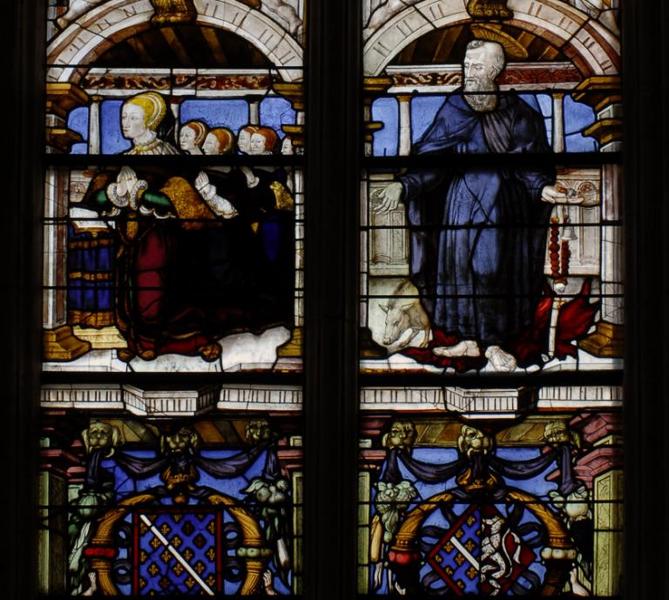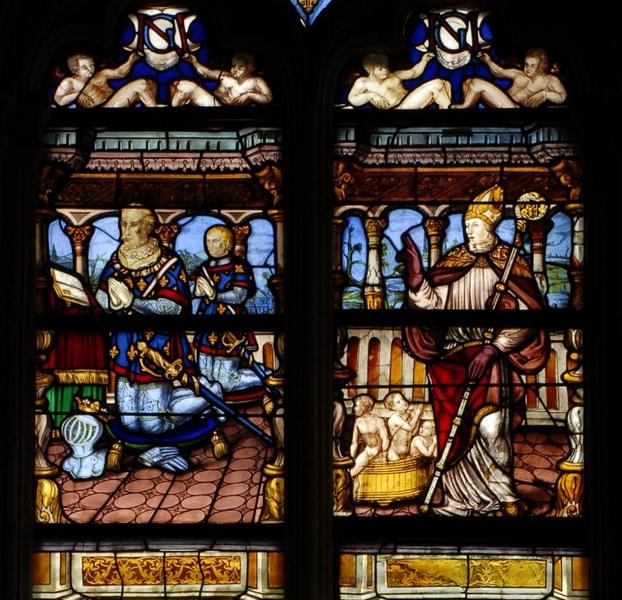Verrières de l'église
Désignation
Dénomination de l'objet
Verrière
Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique
Verrière figurée ; verrière ornementale
Titre courant
Verrières de l'église
Localisation
Localisation
Centre-Val de Loire ; Indre (36) ; Mézières-en-Brenne ; église Sainte-Madeleine
Numéro INSEE de la commune
36123
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Indre
Canton
Mézières-en-Brenne
Nom de l'édifice
Église Sainte-Madeleine
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
En village
Description
Catégorie technique
Vitrail
Matériaux et techniques d'interventions
Verre translucide ; plomb
Dimensions normalisées
Dimensions non prises
État de conservation (normalisé)
Bon état
Historique
Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet
Siècle de création
2e quart 14e siècle ; milieu 16e siècle ; 19e siècle
Description historique
Église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine : Fondée par Alix de Brabant (morte en 1341), dame de Mézières par sa grand-mère Jeanne de Brenne, et épouse de Jean III d'Harcourt (mort en 1326), afin d'accueillir le sépulcre familial, la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Mézières fut élevée entre 1333 et 1339. Elle se compose d'une abside à trois pans et d'une nef à cinq travées, s'ouvrant à l'ouest par un portail à deux voussures, dont le tympan, mutilé lors des guerres de Religion, relate des épisodes de la vie de Marie-Madeleine. L'édifice a été complété à la fin du 15e siècle par la construction d'une chapelle sur son flanc nord. Cette chapelle, aujourd'hui dédiée à saint Pierre, a été fondée en 1489 par Louis d'Anjou, bâtard du Maine, seigneur de Mézières. Son père Charles d'Anjou avait en effet reçu la seigneurie de Mézières des mains de Jean VII d'Harcourt en 1445. Au sud lui fait face une chapelle plus vaste, dite chapelle d'Anjou car fondée en 1543 par Nicolas d'Anjou, petit-fils de Louis. Cet édicule se caractérise par ses voûtes à liernes, à tiercerons et à clefs pendantes, et sa clôture ajourée en pierre, le tout dans le style caractéristique de la première Renaissance. Outre diverses restaurations, la principale modification apportée au 19e siècle résulte de l'élévation, au-dessus du porche occidental, d'un imposant clocher carré, doté d'une flèche flanquée de deux tourelles polygonales, uvre de l'architecte castelroussin Alfred Dauvergne. Les vitraux : L'église Sainte-Madeleine comporte douze verrières, formant plusieurs ensembles distincts, relatifs à chaque moment important de l'évolution de l'édifice. Avec sept verrières anciennes encore à leur emplacement d'origine, de grande qualité malgré les nombreuses restaurations, l'ancienne collégiale de Mézières compte parmi les églises de l'Indre conservant le plus important patrimoine vitré. Le premier ensemble est formé par les trois verrières du chur (baies 0, 1 et 2), vraisemblablement en place lors de la consécration de l'édifice par l'archevêque de Bourges, Foucaud de Rochechouart, le 22 juillet 1339. Leur iconographie s'organise autour de trois thèmes principaux : la Passion du Christ, la Résurrection, et le Couronnement de la Vierge. Une quatrième verrière, datant de la même époque, figure Jean d'Harcourt, défunt époux de la donatrice, et trois de leurs fils (baie 9). Une cinquième verrière lui fait face dans la nef. Entièrement conçue au 19e siècle, celle-ci représente Jeanne de Brenne et Alix de Brabant (baie 12). Les vitraux prévus par Louis d'Anjou pour la chapelle nord ont disparu. D'après le testament du fondateur, l'un d'eux devait représenter Notre-Dame de Pitié. Les deux baies de la chapelle comportent aujourd'hui un saint Pierre et une Visitation, réalisés par Lucien-Léopold Lobin en 1865 (baies 3 et 5). Au sud, la chapelle d'Anjou conserve trois des quatre verrières d'origine, figurant plusieurs membres de la famille de Nicolas d'Anjou présentés par leur saint patron (baies 4, 6 et 8). La baie ajourant le mur ouest de cette chapelle comportait autrefois une Descente de croix, entièrement détruite lors d'une tempête survenue en 1839, remplacée en 1865 par une composition de Lobin (baie 10). Enfin, la grande baie de la façade occidentale présente une grisaille ornementale issue de l'atelier Hucher (fabrique de vitraux du Carmel du Mans) (baie 101). Les vitraux anciens de cet édifice ont été plusieurs fois restaurés. La verrière de la baie 6, figurant René d'Anjou et Antoinette de Chabannes, a été presque entièrement refaite par Emile Thibaud en 1842. Celle de la baie 8, également très refaite par Lucien-Léopold Lobin en 1866, porte aussi des inscriptions relatives aux interventions du peintre-verrier et de son père Julien-Léopold sur les vitraux du sanctuaire. D'autres campagnes de restaurations auront encore lieu par la suite, notamment en 1939, date à laquelle la remise en plomb des verriè res est confiée à Jean-Jacqu
Statut juridique et protection
Statut juridique du propriétaire
Propriété de la commune
Références documentaires
Cadre de l'étude
Dénomination du dossier
Dossier avec sous-dossier
Partie constituante
Verrière (12)
Références des parties constituantes étudiées
IM36002534 ; IM36002538 ; IM36002539 ; IM36002540 ; IM36002541 ; IM36002530 ; IM36002531 ; IM36002532 ; IM36002533 ; IM36002535 ; IM36002536 ; IM36002537
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2009
Date de rédaction de la notice
2009
Adresse du dossier Inventaire
Région Centre-Val de Loire - Service régional de l'Inventaire - 6 rue de la Manufacture 45000 Orléans – 02.38.70.25.06