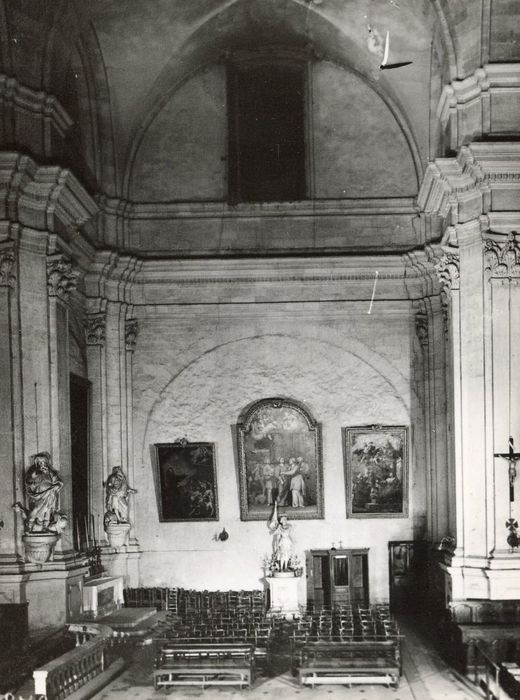tableau : la Visitation
Désignation
Dénomination de l'objet
Tableau
Titre courant
Tableau : la Visitation
Localisation
Localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Bouches-du-Rhône (13) ; Aix-en-Provence ; église Sainte-Madeleine
N° INSEE de la commune au moment de la protection
13001
Nom de l'édifice
Église Sainte-Madeleine
Emplacement de l’œuvre dans l’édifice
Transept sud
Description
Catégorie technique
Peinture
Matériaux et techniques d'interventions
Toile (support) : peinture à l'huile
Description matérielle
Toile cintrée à oreilles.
Indexation iconographique normalisée
Visitation ; sainte Elisabeth ; saint Zacharie ; Vierge ; saint Joseph ; homme ; servante ; fond de paysage ; angelot
Description de l'iconographie
La composition en frise serrée met l'accent sur les trois personnages féminins centraux. Reynaud Levieux choisit des attitudes naturelles (geste tendre d'Elisabeth saisissant Marie par la taille, index de Zacharie guidant la servante qui porte les bagages, geste discrètement réaliste de Joseph s'apprêtant à éponger sa sueur après une longue marche). En même temps il fait preuve d'un réel souci dans les costumes, avec la même exigence d'authenticité que Poussin (sandales, tissus, coiffure). Les visages sont individualisés (l'homme dont la tête est curieusement entourée d'un linge pourrait être un autoportrait). Le paysage est peint à l'heure du crépuscule avec un ciel qui s'obscurcit au terme d'une longue journée de marche.
Dimensions normalisées
H = 360 ; la = 230
Historique
Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet
Personnalités liées à l'histoire de l'objet
Martinozzi Laure (donatrice)
Lieu de provenance
Lieu de provenance : Provence-Alpes-Côte d'Azur, 13, Aix-en-Provence, couvent de la Visitation (chapelle)
Siècle de création
3e quart 17e siècle
Année de création
1660 ; 1665
Description historique
Trois tableaux ont été peints pour le grand couvent de la Visitation à Aix et font partie de la première commande reçue par Reynaud Levieux dans cette ville (1660-1665). Cet ensemble majeur aujourd'hui dispersé était destiné à décorer le somptueux retable en marbre polychrome conservé actuellement dans l'église de Cucuron (Vaucluse), offert en 1661 par Laure Martinozzi duchesse de Modène, nièce du cardinal Mazarin, par amitié pour son ancienne gouvernante Madame de Venel, Madeleine de Gaillard (soeur de l'une des religieuses), protectrice du couvent. D'après une tradition ancienne, Laure Martinozzi aurait fait une étape à Aix au couvent de la Visitation sur le chemin de l'Italie en 1656. Elle aurait promis d'offrir le maître-autel en action de grâces si un fils naissait dans l'année. Ce voeu se réalisa et l'iconographie du retable peut être interprétée comme un ex voto de naissance, avec au centre la Visitation (thème favori de l'ordre), entourée de chaque côté par la Présentation de la Vierge et la Nativité (voir sur Palissy la notice réf. PM13000088), qui a été préférée à l'Annonciation prévue dans le prix-fait de 1660). Le foyer de la cour d'Este fut actif sous François Ier puis sous Alphonse IV, le mari de Laure Martinozzi. Tommaso Luraghi ou Luragho, sculpteur de la cour d'Este, a beaucoup travaillé à Modène. G. Bresc lui attribue la conception du retable des Visitandines. Muttoni, n'étant qu'un scarpellino, s'est limité à monter le riche retable dans le couvent des Visitandines en 1662. 7 juillet 1660 : promesse entre R. Levieux maître peintre d'Avignon et les religieuses du premier couvent de la Visitation Sainte-Marie pour faire trois tableaux à l'huile de sa main pour le maître-autel de l'église représentant Notre-Dame de la Visitation, l'Annonciation de Notre-Dame ou l'Incarnation du Verbe, Notre-Dame au Temple, de 10 pans sur 6, suivant des dessins et moyennant 1200 livres (A. D. Aix, 303 E 310, f° 588, 589). 11 décembre 1665 : dernière quittance (A. D. Aix, 303 E 315, f° 1256). An X, les tableaux sont transportés au dépôt des Andrettes (n° 33, 5, 37). An XI, la Visitation est attribuée à l'église de la Madeleine, la Nativité et la Présentation de la Vierge à l'église Saint-Jean-de-Malte. La Visitation est le plus beau des trois tableaux destinés au retable de ce couvent aristocratique. Pour Philippe de Chennevières, c'est le chef-d'oeuvre du peintre : Je ne crois pas qu'il ait jamais achevé avec autant de bonheur une aussi admirable composition. La donnée même de cette scène de famille, simple et pure, allait à merveille à la puissance de Levieux. La douceur des figures et la sérénité patriarcale des mouvements est là excellente. C'est le tableau qu'il eût fallu acheminer au Louvre. Reynaud Levieux veut séduire et infléchit sa rigueur habituelle pour adopter de façon unique dans son oeuvre les couleurs diaprées de Nicolas Mignard qui donnent à la robe d'Elisabeth des reflets changeants. Reynaud Levieux s'adapte aux exigences de chaque clientèle : raphaëlesque dans ses Saintes Familles, il est ample et majestueux pour la Visitation, sobre et recueilli pour les tableaux destinés aux chartreux. (M.C.H., H.W.) (Sources : Henri Wytenhove).
Statut juridique et protection
Statut juridique du propriétaire
Propriété de la commune
Typologie de la protection
Classé au titre objet
Date et typologie de la protection
1910/09/20 : classé au titre objet
Référence(s) de publication(s)
Wytenhove, Henri, Reynaud Levieux et la peinture classique en Provence : Nîmes, 1613-Rome, 1699, Aix-en-Provence, La Calade, 1990, p. 124-127.
Sources d'archives et bases de données de référence
Henri Wythenove.
Photographies liées au dossier de protection
DOM
Références documentaires
Cadre de l'étude
Dénomination du dossier
Dossier individuel