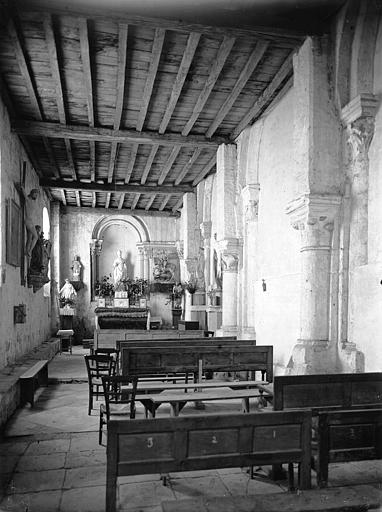Église paroissiale Saint-Georges
Désignation
Dénomination de l'édifice
Église paroissiale
Vocable - pour les édifices cultuels
Saint-Georges
Titre courant
Église paroissiale Saint-Georges
Localisation
Localisation
Hauts-de-France ; Aisne (02) ; Glennes ; rue Françoise-Pasquier
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Braine
Adresse de l'édifice
Françoise-Pasquier (rue)
Références cadastrales
1984 AB 138
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
En village
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
2e moitié 12e siècle ; 4e quart 13e siècle
Siècle de campagne secondaire de consctruction
17e siècle ; 18e siècle
Commentaires concernant la datation
Daté par travaux historiques
Auteur de l'édifice
Description historique
Selon certaines sources, la terre de Glennes aurait été donnée avant le milieu du 9e siècle par Raoul, évêque de Laon, au chapitre de sa cathédrale qui y établit un collège de huit chanoines, finalement réuni à celui de la cathédrale lors des invasions normandes. La première mention apparaît seulement en 1157 dans un acte de donation au chapitre cathédral. L'édifice actuel a été construit au troisième quart du 12e siècle et complété à la fin du siècle par le massif antérieur. Le décor sculpté du choeur et du transept, et notamment celui des chapiteaux du choeur, est très proche, voire identique, de celui de l'église de Lhuys, ce qui pourrait indiquer un même atelier, et peut-être une même main. Les bas-côtés sont élargis à la fin du 13e siècle et les deux premiers piliers méridionaux de la nef sont alors engagés dans de solides massifs. Au 13e siècle, Glennes devient le siège d'une des sept prévôtés du chapitre cathédral de Laon. Ce dernier reste jusqu'à la fin de l'Ancien Régime le gros décimateur de la paroisse qui relève toujours du diocèse de Laon (Grand archidiaconé, doyenné de Neufchâtel).Les murs gouttereaux des bas-côtés sont repris au 17e ou au 18e siècle, notamment au niveau des baies. L'église est restaurée dans les années 1860, puis à nouveau après son classement au titre des Monuments historiques en 1910. Après avoir servi d'hôpital militaire en 1915 et 1916, l'édifice est fortement endommagé lors des combats qui accompagnent le repli allemand à la fin de l'été 1918 (travée nord du massif occidental, bas-côté sud et bras sud du transept). Il est restauré de 1922 à 1936 sous la conduite des architectes des Monuments historiques Lucien Sallez, Paul Genuys puis Jules-François Kaehrling.
Description
Matériaux du gros-œuvre
Calcaire ; pierre de taille ; grand appareil
Matériaux de la couverture
Tuile plate ; calcaire en couverture
Typologie de plan
Plan en croix latine
Description de l'élévation intérieure
3 vaisseaux
Typologie du couvrement
Cul-de-four ; voûte d'ogives ; voûte en berceau plein-cintre ; lambris de couvrement ; charpente en bois apparente
Partie d'élévation extérieure
Élévation ordonnancée sans travées
Typologie de couverture
Toit à longs pans ; appentis ; toit à deux pans ; toit en bâtière ; pignon découvert
Emplacement, forme et structure de l’escalier
Escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour, en maçonnerie
Commentaire descriptif de l'édifice
La nef flanquée de bas-côtés est prolongée d'un transept non saillant avec niches d'autel orientées. La croisée du transept, surmontée du clocher en bâtière, s'ouvre sur l'abside semi-circulaire. La nef est couverte d'un plafond à solives apparentes comme le bas-côté sud, couvrement qu'a perdu lors des restaurations du 20e siècle le bas-côté nord où la charpente est depuis lors apparente et lambrissée. Le premier niveau du massif antérieur, le transept, l'abside et la niche d'autel sud sont voûtés d'ogives. La niche d'autel nord est couverte d'une voûte en berceau plein cintre. Le massif antérieur, qui forme un vaisseau transversal, est surmonté d'un étage en surcroît abritant une salle haute sous comble avec charpente apparente, largement éclairée par onze baies cintrées. Le portail occidental est souligné d'un gâble qui surmonte le porche dont la profondeur permet de corriger l'emprise des contreforts.
Technique du décor des immeubles par nature
Sculpture ; sculpture (étudiée dans la base Palissy) ; vitrail (étudié dans la base Palissy)
Indexation iconographique normalisée
Ornement à forme végétale : acanthe, arum, vigne, rinceau ; ornement à forme géométrique : feuille d'eau ; animal fabuleux ; humain fabuleux
Description de l'iconographie
Les culots supportant la croisée d'ogives de la niche d'autel sud sont ornés de masques. La corniche extérieure de l'abside est ponctuée de masques et de feuilles d'acanthe. Les arcs diaphragmes des bas-côtés reposent sur des feuilles d'eau. Les chapiteaux du choeur, de l'abside et du transept reprennent des arums, des feuilles de vigne et d'acanthe, ainsi que des rinceaux abritant des monstres.
Commentaires d'usage régional
Église à niches d'autel
État de conservation (normalisé)
Restauré
Protection et label
Date et niveau de protection de l'édifice
1910/01/22 : classé MH
Référence aux objets conservés
IM02004180 ; IM02004179 ; IM02004181 ; IM02004424 ; IM02004425 ; IM02004470 ; IM02004512 ; IM02004513 ; IM02004511 ; IM02004514
Intérêt de l'édifice
À signaler
Eléments remarquables dans l'édifice
Abside ; massif antérieur ; chapiteau
Observations concernant la protection de l'édifice
L'église se signale par son abside semi-circulaire du 12e siècle et son massif antérieur, et doit une grande partie de son intérêt à son exceptionnel décor porté sculpté.
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
Propriété de la commune
Références documentaires
Date de l'enquête ou du dernier récolement
1998
Copyright de la notice
© Inventaire général
Date de rédaction de la notice
2007
Noms des rédacteurs de la notice et du dossier
Fournis Frédéric
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
Dossier individuel
Adresse du dossier Inventaire
Conseil régional Hauts-de-France - Service de l'Inventaire du patrimoine culturel 21 mail Albert-Ier 80000 Amiens