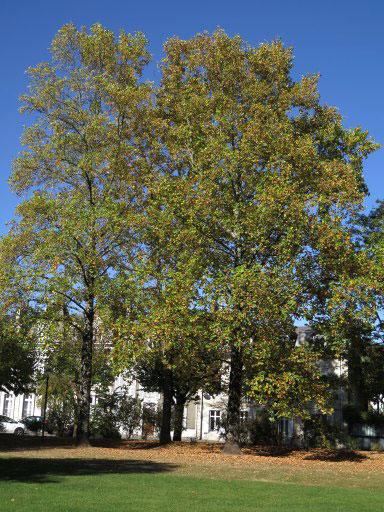Jardin public des Vignaux
Désignation
Dénomination de l'édifice
Jardin public
Appellation d'usage
Des Vignaux
Titre courant
Jardin public des Vignaux
Localisation
Localisation
Occitanie ; Hautes-Pyrénées (65) ; Bagnères-de-Bigorre ; rue Saint-Vincent
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Hautes-Pyrénées
Adresse de l'édifice
Saint-Vincent (rue)
Références cadastrales
2014 AM 195
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
En ville
Partie constituante non étudiée
Arbre isolé ; groupe d'arbres
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
2e moitié 17e siècle ; 3e quart 19e siècle
Siècle de campagne secondaire de consctruction
2e moitié 20e siècle
Personnalités liées à l'histoire de l'édifice
Roquelaure, Maréchal de (commanditaire)
Description historique
A l'origine, il s'agit d'une vigne plantée hors des remparts de la ville, d'où son nom "les Vigneaux". Dès la 2e moitié du 17e siècle, avec la progression du thermalisme, la ville de Bagnères réalise ses premiers aménagements d'urbanisme : des espaces libres sont plantés d'arbres en alignement ou en quinconce pour devenir des lieux de promenade. C'est le cas du jardin des Vignaux qui, bien que relevant d'une propriété aristocratique, devient ainsi le premier jardin public de la ville de Bagnères : "un grand pré fermé de murs de forme carrée où feu M. le Maréchal de Roquelaure a fait planter quelques allées de chênes et d'ormes". Il apparaît ainsi, bien détaché au nord du bourg ancien, sur une vue cartographiée cavalière de la ville (1658). Il est également visible sur un plan de 1714 (parcelle 33) marqué par un calvaire au centre. Le jardin est mentionné sur tous les anciens plans sous l'appellation "promenade des Vignaux" ou "Vigneaux". Il figure aussi sur le plan de la ville de 1789 (A.M.) avec une emprise bien plus grande qu'aujourd'hui puisqu'il couvre une partie de la place du marché (place du Foirail). Acquise par la municipalité en 1791, la promenade des Vignaux subsiste avec la même emprise et les mêmes plantations en quinconce jusqu'au 19e siècle (plan cadastral napoléonien de 1818 et plan récapitulatif de 1846). En revanche, il apparaît amputé de sa partie occidentale et clôturé sur le Nouveau Plan de Bagnères (non daté) et sur le plan Pambrun de 1856, après la création de la rue Saint-Vincent. Sa transformation en jardin paysager remonte très certainement aux années 1860, car le plan d'alignement de 1864 montre le changement radical de parti dans le plan (allées sinueuses) et les plantations. Il devient jardin public en 1867, par arrêté municipal. Le jardin du Vignaux est devenu un parc paysager irrégulier planté d'essences recherchées pour la période. Il répond à une typologie de parc arboretum, selon les pratiques locales encouragées par la mode des jardins anglais et le modèle du Jardin Massey de Tarbes (comme le jardin Géruzet). Les cartes postales des années 1910-1920 témoignent d'un parc au couvert végétal très dense avec des arbres parvenus à leur matûrité. Le tracé des allées, voué aux courbes et contre-courbes, a été modifié au cours de la 2ème moitié du 20e siècle : les nouvelles allées adoptent un plan rayonnant géométrique à partir de la grande vasque circulaire, qui accentue le caractère de jardin public. Le dépérissement des essences, la tempête Xynthia de 2010, ont causé la perte de nombreux sujets anciens. Le parc s'est éclairci mais a fait l'objet de replantations, dans une palette végétale fidèle au catalogue de l'époque romantique.
Description
Matériaux du gros-œuvre
Marbre ; galet ; moellon ; pierre de taille ; maçonnerie ; enduit
Typologie de plan
Jardin irrégulier
Typologie du couvrement
Partie d'élévation extérieure
Jardin de niveau
Couverts ou découverts du jardin de l'édifice
Arbre isolé ; groupe d'arbres ; pièce de gazon ; boulingrin
Commentaire descriptif de l'édifice
Le jardin des Vignaux est aujourd'hui implanté en centre ville, bien qu'en dehors du coeur ancien, en vis-à-vis de la place du Foirail et à proximité du jardin Géruzet. De plan presque carré, il propose un dessin paysager conçu pour faciliter la circulation du public. La composition, géométrisée, s'organise autour d'un rond-point central décalé dans le quart nord-ouest. Il s'agit d'un grand bassin circulaire à margelle de marbre, agrémenté d'un jet d'eau et entouré d'un vaste espace circulaire de déambulation. A partir de ce rond-point rayonnent six larges allées rectilignes. La clôture consiste sur trois côtés en un sous-bassement de moellons et de galets de marbre. Seul subsiste sur le côté sud l'ancien mur de clôture avec sa grille. Le jardin est planté d'essences exotiques centenaires (cèdres du Liban, cèdre Déodar, séquoïa sempervirens ou séquoïa géant, hêtre pourpre, magnolia à grandes fleurs, micocouliers d'Australie, marronniers d'Inde, tilleul commun, tulipiers de Virginie...). Les deux cèdres sont particulièrement remarquables par leur circonférence et leur taille. Le jardin est orné dans l'angle sud-ouest de la fontaine de la Naïade (remploi). Une fontaine de marbre agrémente la bordure occidentale. Des éléments ludiques ont été installés (kiosque, aire de jeux...).
Technique du décor des immeubles par nature
Sculpture ; ferronnerie
Commentaires d'usage régional
Jardin paysager ; jardin public
Protection et label
Intérêt de l'édifice
Intérêt botanique ; à signaler
Observations concernant la protection de l'édifice
Appartient à la filiation des jardins réalisés à la suite du Jardin Massey de Tarbes.
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
Propriété de la commune
Références documentaires
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2014
Copyright de la notice
(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées
Date de rédaction de la notice
2014
Noms des rédacteurs de la notice et du dossier
Fournier Claire
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
Dossier avec sous-dossier
Adresse du dossier Inventaire
Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47