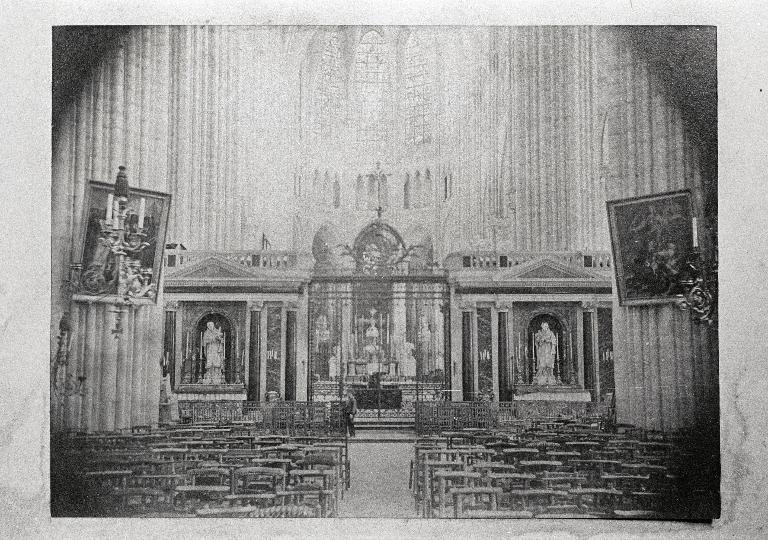Ancien tableau d'autel : la Remise des clés à saint Pierre
Désignation
Dénomination de l'objet
Tableau d'autel
Titre courant
Ancien tableau d'autel : la Remise des clés à saint Pierre
Localisation
Localisation
Hauts-de-France ; Aisne (02) ; Soissons ; Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais ; Cardinal-Binet (place)
Numéro INSEE de la commune
02722
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Soissonnais
Canton
Soissons-Sud
Adresse de l'édifice
Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais ; Cardinal-Binet (place)
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
En ville
Emplacement de l’œuvre dans l’édifice
Bras nord du transept : mur nord
Description
Catégorie technique
Peinture
Structure et typologie
(rectangulaire vertical)
Matériaux et techniques d'interventions
Matériau textile (support, en 2 lés) : peinture à l'huile
Description matérielle
Le tableau, peint à l'huile sur toile, est de forme rectangulaire et verticale. La toile semble formée de deux lés juxtaposés.
Description de l'iconographie
Le tableau de Philippe de Champaigne illustre un passage de l'Évangile selon saint Matthieu (chapitre XVI, versets 18-19). Au premier plan, le Christ debout et de trois-quarts, désigne le ciel de la main gauche, tandis qu'il remet deux clés - une clé d'or et une clé d'argent - à saint Pierre. Ce dernier, agenouillé de profil devant le Christ, tend la main droite pour recevoir ces clés qui font de lui l'intendant du royaume des Cieux et qui l'élèvent au rang de premier apôtre. Immédiatement derrière eux, sont représentés les onze autres apôtres, dont le groupe compact occupe la presque totalité de la toile. La scène semble silencieuse, toutes les bouches étant fermées, mais les gestes des mains et l'échange intense de certains regards semblent traduire la surprise. Parmi tous ces personnages, le Christ attire particulièrement le regard par sa taille, légèrement plus grande que celle des apôtres, par la lumière qui le frappe, tandis que les apôtres semblent dans l'ombre, enfin par la couleur de ses vêtements (le rose et le bleu vif), alors que les apôtres portent des couleurs plus sombres et ternes. Si tous les visages sont individualisés, ils semblent néanmoins conventionnels, à l'exception d'une tête d'homme sur la droite, qui est bien ancrée dans le milieu du 17e siècle et qui pourrait être un portrait. Le paysage est peu présent : à gauche, derrière le Christ, se distingue difficilement la tour crénelée d'une ville où culmine un bâtiment, évocation probable de Jérusalem dominée par le temple. À droite, est représentée la masse imposante et anachronique de Saint-Pierre de Rome, symbole de la nouvelle Église fondée par le Christ et dont saint Pierre a été le premier vicaire.
Dimensions normalisées
Mesures approximatives de la toile : h = 190 ; la = 150.
État de conservation (normalisé)
Oeuvre restaurée
Précisions sur l'état de conservation
Plusieurs restaurations successives sont attestées depuis le début du 19e siècle.
Historique
Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet
Personnalités liées à l'histoire de l'objet
Dubois Charles (donateur)
Lieu de création
Lieu d'exécution : 75, Paris
Etape de création
Pièce originale (de peinture)
Siècle de création
3e quart 17e siècle
Description historique
En 1663, le chapitre décide de remplacer l'ancien jubé médiéval, endommagé en 1567 par les protestants, par un nouveau jubé dont la première pierre est posée en 1664 et qui est achevé en 1666. Ce jubé comporte deux autels, l'un consacré à saint Pierre, au nord de la porte centrale, et l'autre consacré à la Vierge, au sud de la même porte. Pour orner ces deux autels, le chanoine Charles Dubois offre deux tableaux qu'il a fait réaliser à Paris par "M. de Champaigne". L'artiste n'est autre que Philippe de Champaigne, comme le confirme Guillet de Saint-Georges, historiographe de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Le tableau représentant la Remise des clés à saint Pierre est destiné à l'autel Saint-Pierre, tandis que l'autel de la Vierge est décoré d'une Assomption. La réfection du jubé à partir de 1767 entraîne la dépose des deux tableaux. Les deux autels adossés au jubé, qui portent cette fois les vocables de saint Gervais et de saint Protais, sont surmontés chacun de la statue du martyr respectif, et, jusqu'aux dernières années du 18e siècle, il n'est plus fait mention des deux toiles de Philippe de Champaigne.Dans les premières années de la Révolution, la cathédrale est transformée en magasin d'effets militaires. Mais quelques tableaux y sont encore conservés. Quatre d'entre eux, dont ceux de Philippe de Champaigne, sont jugés dignes d'être envoyés au Museum à Paris. Le 30 décembre 1794, le citoyen Pierre Hutin, administrateur du district de Soissons, prévient la Commission temporaire des Arts que les quatre tableaux ont été placés dans des caisses d'une taille peu ordinaire. Les deux toiles de Philippe de Champaigne, qui ont été retrouvées repliées sur leur châssis, sont dans une caisse de 7 pieds sur 4. Faute de voiture propre à les transporter, les caisses restent à Soissons et sont remisées dans les locaux de l'ancienne Intendance. L'École centrale d'Instruction supérieure est créée à Soissons dans les mêmes locaux, le 28 février 1796. Les tableaux qui y sont rassemblés constituent alors un embryon de museum. Mais l'École centrale de Soissons est supprimée au début du 19e siècle.Le Consulat ramène l'apaisement après la période révolutionnaire. Un évêque est nommé à la tête de l'évêché de Soissons en avril 1802, et un conseil de fabrique administre le temporel de la cathédrale. L'édifice manque à cette époque d'objets indispensables au culte et, bien évidemment, d'ornementation. Il apparaît alors que plusieurs beaux tableaux à sujet religieux sont conservés dans les bâtiments de l'École centrale, et qu'ils contribueraient parfaitement au décor de la cathédrale. Une demande est adressée au préfet en juillet 1803 et aboutit à l'envoi très rapide de plusieurs tableaux, dont les deux toiles de Philippe de Champaigne qui sont alors dépourvues de cadre. Le 15 septembre 1803, la Fabrique décide de les faire réparer et nettoyer, puis de les placer aux autels qui se dressent dans les deux bras du transept, la Remise des clés étant destinée à l'autel du croisillon nord. Des délégués du conseil de Fabrique sont également chargés de faire exécuter un encadrement en plâtre surmonté de petits chérubins, peint d'une couleur unie ou marbrée. Vers 1826, la Remise des clés est restaurée par le peintre soissonnais Jean-René Chevalier, professeur dans l'École de dessin que la municipalité avait fondée en novembre 1804. Mais son cadre, qui ne répond plus à la beauté retrouvée du tableau, est remplacé peu après par un cadre doré à l'or bruni, réalisé par Gramet, doreur et peintre à Soissons. On ne sait à quelle époque les deux tableaux de Philippe de Champaigne quittent les deux bras du transept pour deux piliers de la croisée. Mais l'Inventaire de 1836 les signale déjà à ce nouvel emplacement, qu'ils ont gardé jusqu'au moment de la destruction du jubé et du réaménagement du transept dans le courant des années 1860, et cela en dépit de multiples protestations du conseil de Fabrique qui leur reprochait de rompre les lignes de l'architecture. Quelques auteurs, dont Delorme, affirment que l'Assomption de Philippe de Champaigne a été donnée au tout début du 19e siècle à l'église de Billy-sur-Aisne, pour en orner le maître-autel. Le grand tableau rétrocédé à cette église par le conseil de Fabrique de la cathédrale est bien une Assomption, comme en témoigne une ancienne carte postale représentant le chœur de l'église de Billy-sur-Aisne. Cependant, il ne s'agit pas d'une œuvre de Philippe de Champaigne, mais d'une copie ou d'une répétition de l'Assomption peinte par Laurent de La Hyre en 1635 pour les Capucins de la rue Saint-Honoré à Paris. Avant la Révolution, cette copie ornait à Soissons l'église du couvent des Célestins, et elle était entrée à la cathédrale en 1803, avec une quinzaine d'autres peintures provenant de l'École centrale. L'Assomption de Philippe de Champaigne est donc restée dans la cathédrale, probablement jusqu'à la Première Guerre mondiale.La Remise des clés à saint Pierre est revernie en 1857 par M. Betbéder, professeur de dessin et peinture à Soissons. Puis le tableau et son pendant quittent la croisée du transept vers 1865 pour d'autres espaces de la cathédrale. Au début du 20e siècle, il orne l'entrée du collatéral nord de la nef, tandis que l'Assomption décore peut-être la chapelle des Œuvres. La Remise des clés à saint Pierre a gagné le bras nord du transept après la restauration de la cathédrale consécutive à la Première Guerre mondiale. En revanche, l'Assomption a disparu pendant le conflit.
Statut juridique et protection
Statut juridique du propriétaire
Propriété de l'Etat
Date et typologie de la protection
classé au titre objet
Intérêt de l'objet
À signaler
Références documentaires
Cadre de l'étude
Dénomination du dossier
Dossier individuel
Partie constituante non étudiée
Cadre
Intitulé de l'ensemble
Ensemble des trois jubés successifs de la cathédrale (œuvres détruites)
Référence de l'ensemble
IM02005382
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2004
Date de rédaction de la notice
2012