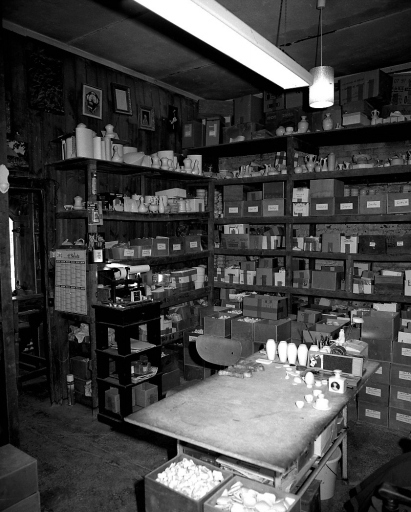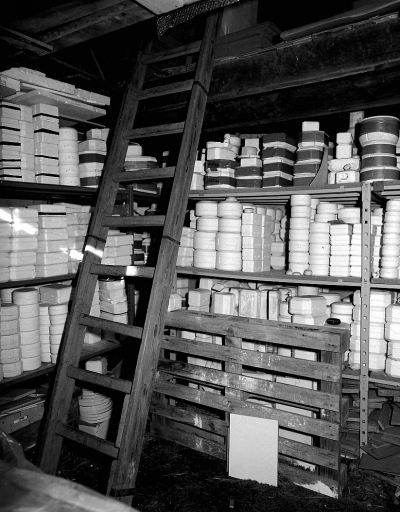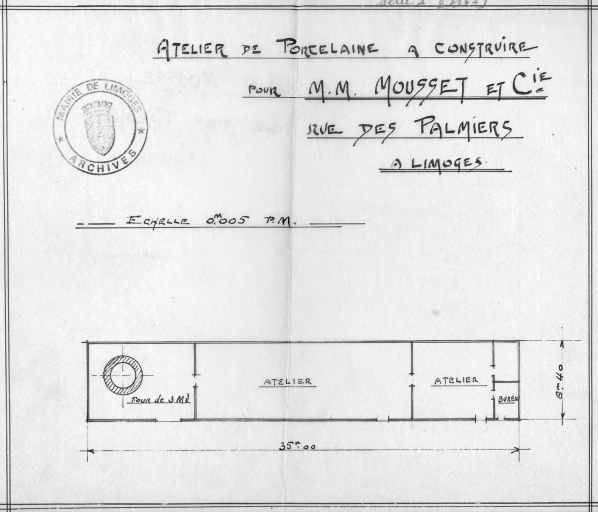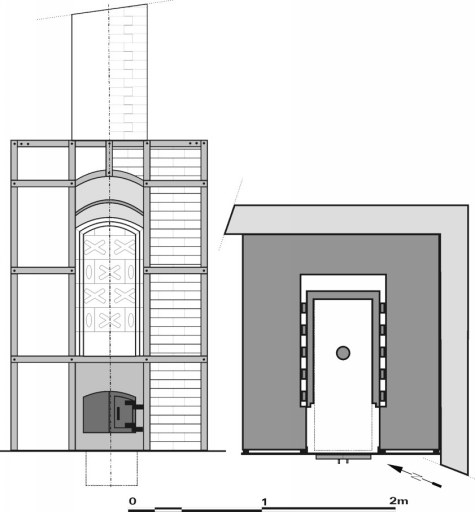Usine de porcelaine Mousset et Cie, puis Cloups, puis Laplagne
Désignation
Dénomination de l'édifice
Usine de porcelaine
Appellation d'usage
Usine de porcelaine Mousset et Cie, puis Cloups, puis Laplagne
Titre courant
Usine de porcelaine Mousset et Cie, puis Cloups, puis Laplagne
Localisation
Localisation
Nouvelle-Aquitaine ; Haute-Vienne (87) ; Limoges ; 24 avenue Galliéni
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Limoges
Canton
Limoges-Corgnac
Adresse de l'édifice
Galliéni (avenue) 24
Références cadastrales
2002 BH 34, 91, 92, 96
Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire
En ville
Partie constituante non étudiée
Atelier de fabrication ; magasin industriel
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
1er quart 20e siècle
Année(s) de(s) campagne(s) de construction
1924
Commentaires concernant la datation
Daté par source
Auteur de l'édifice
Description historique
Raoul Mousset, Léon Cloups et François Gaumondi établissent cette petite usine de porcelaine en 1924 (société en nom collectif Mousset et Cie). Après le décès de R. Mousset dès les premières années, puis de F. Gaumondi à la fin des années 1940, L. Cloups reste seul à la direction de l'entreprise. Ouvrier dans diverses usines de porcelaine depuis l'âge de 11 ans (dont l'usine Ranque-Ducongé spécialisée dans la fabrication de fèves) , Léon Cloups était âgé de 22 ans à la création de la société. En 1964 lui succède son gendre, Henri Laplagne, modeleur de formation (meilleur ouvrier de France) auquel succède sa fille en 1995, Nadège Laplagne, actuelle propriétaire et directrice. Spécialisée dans la fabrication de porcelaine blanche de fantaisie (porcelaine d'ameublement, piluliers, fèves, porcelaine funéraire...) , cette usine fabriqua des objets très variés, tels que les petits équipements sanitaires en porcelaine du paquebot Normandie (1935). L'usine est équipée en 1924 d'un four rond à globe de 3 m3, à flammes directes. En 1958 il est remplacé par un four-cellule à gaz du constructeur Cerafer (Golfe-Juan, 06). Il subsiste une ancienne moufle, probablement construite dans les années 1920, du constructeur de Limoges P. Blondeau (indications portées sur les portes du foyer). L'usine emploie 11 ouvriers en 1926 dont 7 femmes, 7 ouvriers en 1985, 12 en 2002.
Description
Matériaux du gros-œuvre
Brique ; fer ; bois ; pan de bois
Matériaux de la couverture
Ciment amiante en couverture
Description de l'élévation intérieure
En rez-de-chaussée ; étage de comble
Typologie de couverture
Toit à longs pans
Commentaire descriptif de l'édifice
L'usine est constituée d'un long bâtiment, où se succèdent le bureau, le magasin industriel, l'atelier du four de cuisson, celui du four de dégourdi et du délayeur à barbotine, l'atelier de fabrication proprement dit, l'atelier de l'ancien four rond et celui de la moufle, ces deux derniers étant reconvertis en entrepôt de moules à porcelaine. Les combles sont entièrement occupés par le stockage de moules. Le bâtiment est en pan de bois et en brique, couvert d'un toit à longs pans en plaques de fibro-ciment. Des poteaux intermédiaires en bois, à aisseliers, portent les planchers des combles. Les cloisons entre les ateliers sont en bois, tandis que les planchers sont en parquet. La moufle, ancien four à décors, est en brique, frettée de fer plats. Elle mesure 2, 30 m de hauteur, 1, 4 m de largeur et 1, 6 m de profondeur. De forme parallélépipédique, elle est surmontée d'une cheminée de section carrée, en brique. La moufle se compose d'un foyer (avec portes en fonte) , surmontée de la chambre de cuisson, voûtée. Celle-ci mesure 45 cm de large, 80 cm de profondeur, 90 cm de hauteur sous voûte. La paroi est doublée d'éléments réfractaires, avec motifs géométriques en creux (croix et cercles). Cette paroi est distante d'une dizaine de centimètres du massif maçonné de la moufle, évitant le contact des gaz de combustion et des pièces décorées en cours de cuisson.
Protection et label
Référence aux objets conservés
IM87001666 ; IM87001668 ; IM87001667
Intérêt de l'édifice
À signaler
Eléments remarquables dans l'édifice
Four industriel ; machine de production (étudiée dans la base Palissy)
Observations concernant la protection de l'édifice
Le four de 1924 conservé dans cette usine est l'un des cinq derniers fours ronds subsistant à Limoges, et l'unique exemple de petit four rond à globe du début du 20e siècle. La moufle, de la même période, est au même titre particulièrement intéressante.
Statut juridique
Statut juridique du propriétaire
Propriété privée
Références documentaires
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2002
Copyright de la notice
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Limoges
Date de rédaction de la notice
2002
Noms des rédacteurs de la notice et du dossier
Pillet Frédéric
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
Dossier avec sous-dossier
Adresse du dossier Inventaire
Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de la Région - Service du Patrimoine et de l’Inventaire, site de Limoges - 27, boulevard de la Corderie - CS 3116 - 87031 Limoges Cedex 1 - 05 55 45 19 00