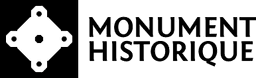Description historique
La filature des Calquières de Langogne est un musée ouvert depuis le 1 er juillet 1994. En 1996, d'importants travaux de restauration sur les cardes (fileuse, nappeuse et bobineuse), la Mule Jenny, ainsi que des travaux de regarnissage ont été confiés à deux entreprises (GRAF France SARL à Illzach et GUIFFRAY et Cie à Vienne). L'existence du moulin est attestée dès le 15e siècle. L'usine est une filature de laine qui, à un niveau quasi artisanal, a fonctionné de 1853 à 1990. Elle est la dernière filature artisanale dans le sud du Massif central. Son intérêt majeur réside dans l'ensemble de machines de filature anciennes, présentes et en bon état de marche. La plupart sont antérieures au début du XX° siècle, ce qui est exceptionnel. Le bâtiment comporte un soubassement, un rez-de-chaussée surélevé, deux étages carrés et des combles basses. Ce sont des étages de travail qui correspondent au processus de fabrication du produit lainier. La répartition des activités se fait par étage, avec des machines correspondant à une fonction. A l'étage de soubassement se trouve l'énergie motrice. Là, sont réalisées les étapes de lavage et de battage de la laine. Le cardage s'effectue au rez-de-chaussée. Le filage se fait au premier étage. Une machine à filer du type Mule Jenny, datant de 18501860, de fabrication française, est le seul exemplaire subsistant en France. La dernière étape est réalisée au deuxième étage. Le double moulinage s'y fait avec du matériel plus artisanal, datant de 1870-1880. La filature se situe en ville, une centaine de mètres au sud de l'enceinte médiévale, dans un quartier urbanisé aux 18e et 19e siècles, au bord du ruisseau de Langouyrou (sources Cécile Vanlierde en 2016). En 1442 moulin à blé et à seigle vendu par le prieur de Langogne à Jean Tuffier, l'acte mentionne le béat ainsi qu'une cuve de tannage ; au 16e siècle moulin à farine et foulon avec logement du meunier ; 1754 reconstruction après crues dévastatrices ; 1828 achat par Boyer pierre, teinturier ; 1842 modification et surélévation, transformation probable en filature et tissage attestés en 1853 ; vers 1850, établissement d'un atelier de teinturerie dans une maison voisine ; vers 1860 moulin transformé en tissage ; 1908 Engles Henri, gendre Boyer ; vers 1920 arrêt du tissage ; 1990 retraite de Engles Louis, petit fils d'Henri, fin de la production ; 1992 vente à la commune de Langogne ; 1994 restauration partielle, classement M.H. des machines et inscription M.H. du bâtiment, ouverture au public comme usine musée. Depuis 1856 roue verticale à augets en bois de 3, 85 m de diamètre, d'une puissance de 4 Ch, restaurée en 1981 ; 1853 un assortiment de cardes, 3 mules Jenny avec 270 broches et 2 métiers à tisser ; vers 1860, passage à 360 broches et à 5 métiers. 1881, 15 ouvriers ; vers 1910, 8 à 15 ouvriers selon les saisons. Existence d'un fonds d'archives privées. Le bâtiment de la filature Boyer, puis Engles, rue des Calquières, résulte de la surélévation avec alignement de façade en 1842 d'un moulin (Moulin Boyer) attesté dès le 15e siècle pour les grains (seigle et froment) et le drap (foulons), cette dernière fonction ayant perduré jusqu'au début du 20e siècle. La partie supérieure est filature de laine jusqu'en 1853 où elle possède déjà 400 broches. L'énergie provient d'une dérivation (béat) du Langouyrou qui alimente d'autres établissements (dont une minoterie toujours en activité) tous situés en amont. Sur le plan architectural, le bâtiment comporte un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé, deux étages carrés et des combles basses. Il offre des élévations très représentatives de la période et de la région avec une réalisation de qualité moyenne. Son intérêt, à ce titre, n'est pas exceptionnel. Il est toutefois inclus dans un ensemble d'immeubles, dont certains nettement plus anciens. On note l'emploi précoce pour la Lozère de la tuile creuse et de la génoise et surtout de la présence au niveau supérieur d'un plafond suspendu solidaire de la panne faîtière (sources Michel Wienin, 1992-1993).